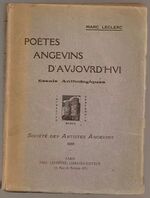Poètes angevins par M. Leclerc - Olivier de Rougé
|
Le Comte Olivier de Rougé, Sénateur de Maine-et-Loire, Président
de la Société des Eleveurs de la race « Maine-Anjou » et de toutes
les grandes Sociétés Agricoles de l'Ouest, est né le 15 janvier 1862 à
Chenillé-Changé ; petit-neveu de ce Gabriel Louis de Rougé, Marquis
de Cholet, qui donna un élan considérable à l'industrie textile et à
l'élevage, à la fin du XVIIIe siècle, M. de Rougé n'a pas démérité
des traditions de sa race.
Possesseur d'un beau nom, d'une belle fortune, et d'un beau domaine, il eût pu comme tant d'autres vivre une vie facile de gentilhomme terrien ou parisien, et nul, sauf lui peut-être, ne s'en fût étonné, en ce paisible Anjou si porté par essence à la tranquillité.
Mais M. O. de Rougé n'a pas voulu être tranquille : Homme politique, journaliste, chroniqueur, romancier, agronome, agriculteur, poète aussi, il dépense en des domaines si divers une constante et prodigieuse activité, dont peut-être nous trouverions le secret dans un besoin d'action à tout prix pour échapper à la pensée douloureuse d'un deuil paternel inguérissable. « Je suis un grand blessé du cœur, resté inconsolable », m'écrivait-il. Et de cette blessure, maintes fois, nous trouvons la marque dans son volume Les Epaves :
- MES DEUX LYS
- J'avais planté deux lys au seuil de ma maison :
- Et ces deux lys poussaient des touffes merveilleuses...
- Mes lys, épanouis en fleurs prestigieuses,
- Parmi les autres fleurs... encore plus radieuses,
- A toute heure du jour et par toute saison.
- Trop vite, hélas, mes lys avaient voulu fleurir !
- Chères fleurs, dont j'ai vu la royale cambrure
- Fléchir sous les efforts de la lente morsure,
- N'avez-vous jusqu^au bout gardé votre parure
- Que pour mieux embaumer un plus doux souvenir ?
- Le seuil de ma maison n'est plus comme jadis...
- Ses marches ne sont plus par mes lys embaumées,
- Les volets en sont clos et les portes fermées,
- La mort, qui me trompait, a pris ses fleurs aimées !
- La mort, qui me laissait, a fauché m,es deux lys !
- Lorsque vous passerez au seuil de ma maison.
- Pressez plutôt le pas et détournez la tête :
- La mort habite là... la mort toujours en quête,
- La mort qui prit mes lys ! La mort que je regrette,
- Et qui n'a même pas emporté ma raison !
En plus de la fidélité aux laborieuses vertus de sa famille, c'est pour lui un besoin moral que d'agir, et un soulagement à son mal, et écrire, écrire des vers, est une de ses façons d'agir :
- Les vers sont accourus sous ma plume au galop
- Dès le jour où mes doigts ont entrepris d'écrire :
- Pauvres vers, la plupart, et qui feraient sourire,
- Et que j'ai tous aimés cependant beaucoup trop.
- Mais, si j'ai tant aimé les vers qui m'ont bercé,
- C'est qu'aux plus mauvais jours il me furent fidèles...
- C'est qu'ils m'ont emporté dans le vol de leurs ailes
- Quand ils m'ont rencontré sur la route, harassé !
On trouve, tout au long de ce livre, des pièces d'une véritable émotion, et d'une noble inspiration ; quant à la technique de l'auteur, lui-même nous en donne les éléments, dans un Art politique personnel, qu'il a formulé en vers :
- Il n'y a pas de prosodie :
- Il faut tout laisser faire au goût !
- Laissez passer tous les délires,
- Laissez vibrer toutes les lyres,
- Laissez monter tous les encens !
- Donc, chantez au fil de vos rêves,
- Sans vous préoccuper des vers…..
A vrai dire, nous voici assez loin de l'Art Poétique de Boileau... que tant vitupèrent aujourd'hui en public, qui dans le secret pratiquent l'adage : « Vingt fois sur le métier »... Mais M, de Rougé est trop honnête homme pour ne pas se conformer le premier aux doctrines qu'il prêche ; nous aurions préféré quelquefois l'y voir infidèle, et nous pensons que certaines de ses pièces, heureuses de rythme et de pensée, eussent gagné à être un peu plus serrées de forme et plus élaguées. Mais n'en gardons pas rancune à l'Auteur : comme il le dit, les « vers accourent sous sa plume au galop », et l'on ne peut demander aux allures vives la perfection d'un travail de manège.
Le second volume de vers de M. Olivier de Rougé a pour titre : Poèmes du Temps de Guerre. Mon Confrère Philippe Doré, qui est un écrivain sportif d'une sorte rare — puisqu'il écrit, en un excellent français, des articles pleins d'idées générales — émettait l'autre jour (1) sur la littérature de guerre de l'arrière un jugement si sévère que je
- (l). « La Naissance de l'Aviation », Revue Française, 20 novembre 1921.
n'ose le rapporter ici pour ne pas peiner une seconde fois de bons auteurs que malgré tout j'estime, mais qui traduit exactement l'état d'âme des combattants vis-à-vis de ces récits ou de ces poèmes où ils se reconnaissaient si peu : C'est que cette Guerre fut si différente de tout ce qu'on avait vu jusque là, que toute documentation était vaine, qui se rapportât à des époques antérieures, et n'eût pas été prise sur place, et vécue. Il fallut la fin de la tourmente pour voir sortir les œuvres douloureuses et vraies des « Ecrivains-Combattants », des Dorgelès, des Duhamel, des Henry Jacques, des Malherbe, des Paul Verlet — je cite au hasard — qui, ceux-là, avaient vu et vécu la Guerre. Mais, tandis qu'elle durait, ceux-là n'écrivaient guère, et pour cause, et la Censure, d'autre part, muselait de son mieux la Vérité, pour ne pas décourager ce « moral des Civils », qu'il fallait bien soutenir. Et les écrivains de l'Arrière en étaient réduits aux récits de 70, aux chromos d'après Alphonse de Neuville, ou à ces « reportages du Front » trop souvent pris, hâtivement, sur la proche frontière de la « Zone des Armées », et qui nous valurent le type exécrable du Poilu cascadeur, faisant des pieds de nez aux Boches sur le dessus de la tranchée, et appelant sa baïonnette « Rosalie »…..
Il y avait là pour les auteurs un écueil terrible, où les meilleurs ont échoué, et je ne puis dire que M. de Rougé l'ait toujours évité... je crois même, Dieu me pardonne, qu'il nous a parlé de « brandir Rosalie » !... Aussi, malgré l'émotion vraie de pièces comme celle où il nous dit la mort de Pierre de Terves, combien je préfère le volume publié après celui-ci, les Pages Romaines !
C'est que là l'auteur s'est tracé un plan d'ensemble, que sa connaissance des lieux et sa parfaite possession des auteurs latins l'ont heureusement servi, et que la grandeur de son sujet l'a fortement inspiré. « Marquer les heures principales de Rome au cours de ses évolutions, à chacune de ces heures demander un épisode qui fixe les mœurs et le caractère de l'époque », tel fut le dessein de M. de Rougé. Il est malheureusement impossible, dans une si courte étude, d'analyser ou de citer des pièces comme L'Angélus, La Dernière Heure d'Ovide, Le Pape, ou cette Mort du Tasse, qui offre, avec moins de concision, des ressemblances avec le beau poème de Paul Sonniès sur la mort de Du Bellay, que nous avons cité. A peine pourrons-nous extraire quelques vers de la dernière page du livre :
- Tout à l'heure on eût dit qu'avant de s'incliner
- Au sourire du soir venu pour l'entraîner.
- Le soleil ébloui de sa propre lumière
- S'attardait au regret de finir sa carrière...
- Dans la pourpre et l'azur d'un merveilleux décor
- Saint Pierre se nimbait d'une poussière d'or...
- Les marbres s'allumaient sur les larges façades
- Et leurs flammes couraient le long des colonnades….
- Et puis l'ombre est sortie à travers le pavé.
- Elle monte et s'étend : c'est l'heure de l'Avé.
- L'Ave ! pieux soupirs mélangés de prière...
- Et la nuit maintenant a déployé ses ailes...
- Et le silence dort aux quatre cents chapelles...
- Et je veille... Mon rêve a repris les détours
- Des siècles dont ces lieux ont vu passer le cours :
- Les morts de tous les temps, secouant la poussière,
- Ont rassemblé leurs os pour sortir de la terre,
- Et défiler sous mes regards épouvantés…..
BIBLIOGRAPHIE. — Epaves, poèmes, Paris, Bernard-Grasset, 1913. — Poèmes du Temps de Guerre, ibid. 1917. — Pages Romaines, ibid, 1920. — Autour de la Guerre, esquisses et profils, Paris, Berger-Levrault, 2 volumes, 1916-1917. — (Sous le pseudonyme de Pierre Cherré) : La Métairie de Chantemerle, roman de guerre, Angers, Librairie Chaperonnière, 3 volumes, 1915-1916. 1917. — La Cloche de Bourdigné, roman de guerre, ibid. 1918.
Extrait de l'ouvrage Poètes angevins d'aujourd'hui, essais anthologiques de Marc Leclerc, Société des artistes angevins, Paul Lefebvre libr.-édit. (Paris), 1922, 134 p.
Marc Leclerc (1874-1946), homme de lettres angevin, créateur des rimiaux, peintre, conférencier, membre de la Société des artistes angevins.
Olivier de Rougé (Chenillé-Changé 1862-1932), agronome, à l'origine de la race bovine Maine-Anjou (devenue Rouge-des-prés en 2003), homme de lettres et homme politique.
Du même ouvrage : Table (liste des poètes), Auguste Pinguet, Émile Marchand.
Littérature — Culture — Territoire — Patrimoine — Économie — Administrations — Documents