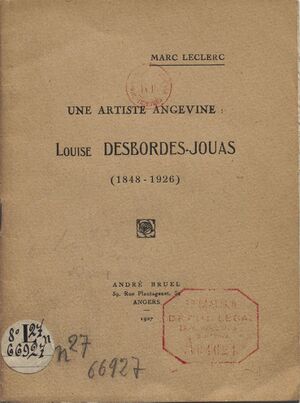Louise Desbordes-Jouas par M. Leclerc
|
Le 18 août dernier, après les longues et terribles souffrances d'un mal qui ne pardonne pas, s'éteignait à Créteil, dans ce pavillon parmi les fleurs à demi sauvages qu'elle affectionnait, Mme Louise-Alexandra Desbordes-Jouas. Août, l'époque des absences : à la « Société des Artistes Angevins », nous étions tous dispersés de ci, de là, et personne d'entre nous ne put aller rendre un dernier hommage à celle qui avait été parmi les premiers fondateurs, et l'une des plus dévouées sociétaires de notre groupement, et porter à son mari, le bon graveur Charles Jouas, le témoignage de nos sympathies attristées.
Quelque temps après, Henry Coûtant, dans la presse angevine, publiait un premier article pour saluer la mémoire de la disparue, mais il était convenu entre nous qu'une étude plus complète devait paraître, sur la vie et les œuvres de cette femme de grand talent et de grand cœur. Aujourd'hui que j'ai pu, aidé par les pieuses recherches de Charles Jouas, retrouver, sur un passé déjà lointain, quelques-uns de ces documents que son ombrageuse modestie avait tenus cachés durant sa vie, je tenterai l'épreuve de dire, au nom de la Société des Artistes Angevins, un peu de ce que fut cette très belle artiste.
Nous savions bien, tous, qu'elle n'était plus jeune... et pourtant ce nous fut une stupeur, à la lecture de son faire-part de décès, de constater qu'elle était notre doyenne : notre cher Paul Pionis n'était que son cadet, car elle était née rue St-Aubin, à Angers, le 4 février 1848, de François-Lucien Desbordes, et de Joséphine-Louise Bouter ; le 1er juillet suivant, elle était baptisée à Saint-Maurice, où son parrain fut M. Joseph Papin.
La vie, plus tard, l'entraîna ailleurs, mais de cette naissance angevine elle eut toujours la fierté. Nous avons vu de grands artistes, comme Anatole France et Réjane, mettre jusqu'à la fin une singulière obstination à renier leur origine provinciale, et à ne pas avouer qu'ils étaient « de chez nous »... d'autres, il est vrai, envers qui l'existence semblait avoir tout fait pour les détacher de leur petite patrie, ne l'oublièrent jamais, tel Achille Cesbron, le Maître des fleurs, ou le magnifique acteur Duquesne, Angevin fervent ; Louise Desbordes fut de ceux-ci.
Son père, Lucien Desbordes, un artiste original et complet, était, lorsqu'elle naquit, organiste à Saint-Maurice. Nous le voyons plus tard diriger l'orchestre du Théâtre de Bordeaux ; et c'est de là, peut-être, que date, pour sa fille, cette vocation scénique qu'elle suivit tout d'abord. De Bordeaux, Lucien Desbordes vint s'installer à Paris, où, tout en restant musicien, il se révélait aussi sculpteur humoriste fort spirituel, modelant des « charges » en terre cuite, vendues avec succès sous les Galeries du Palais-Royal ; charges, surtout, de robins, avocats ou magistrats, plaisantes sans méchanceté ni sans fiel : il refusa toujours de verser dans la satire politique ou religieuse ; un de ces masques minuscules nous est resté, d'une très alerte facture, et c'est justement celui de l'auteur lui-même, cet artiste de belle humeur, qui toujours ignora la haine et qui légua sa bonté à sa fille, parmi d'autres dons précieux.
Le 2 août 1867, Louise Desbordes, élève du Conservatoire Impérial, reçut au concours le premier accessit de grand opéra. Première chanteuse de la Chapelle de l'Empereur, elle fut presque aussitôt engagée à l'Opéra, où semblait l'attendre une brillante carrière musicale ; et c'est ainsi qu'elle créa, le 4 mars 1869, le rôle de « Dame Marthe » dans « Faust » ; et telle caricature de la « Vie Parisienne » de cette époque, due sans doute à la plume de Marcelin, nous la montre, de profil, coiffée en bandeaux sous un chaperon à crevés fort romantique.
Mais là n'était pas sa voie véritable ; l'existence des coulisses, même à l'Académie Nationale de Musique, convenait peu à la réserve et à la timidité de celle qu'on appelait alors « La Belle Angevine », timidité qu'elle garda, du reste, jusqu'à ses derniers jours : la rencontre d'Alfred Stevens, alors dans toute sa gloire, vint la révéler à elle-même, et elle fut vite son élève, son élève préférée. Un portrait de cette époque, signé d'une autre élève de Stevens, Mme Clémence Roth, nous la montre dans la rayonnante splendeur de sa jeunesse : elle était vraiment la Belle Angevine ; ceux qui ne l'ont connue que dans un âge avancé déjà n'avaient pas de peine à imaginer qu'elle avait dû être, en effet, très belle ; la douceur et la régularité des traits, une fraîcheur qui ne devait rien aux fards, et le charme très doux du regard et du sourire, lui étaient restés à cette époque de la vie où tant de femmes ne sont plus que décrépitude.
Un des familiers de l'atelier Stevens était le bon poète-chansonnier Gustave Mathieu, celui-là même qui fonda — ô le brave homme ! — le Journal et l'Almanach de « Jean Raisin » ; ancien marin, le poète, jamais embarrassé, avait plusieurs cordes à son arc, et s'était fait représentant de commerce et marchand de tableaux ; c'est ainsi qu'il allait vendre les toiles de la jeune artiste, qui n'eût jamais eu l'audace d'aller elle-même proposer ses œuvres ; profits, du reste, aussitôt absorbés par une passion qu'elle eut toute sa vie, celle des bibelots et des gemmes : l'argent remis par le bon Mathieu filait incontinent chez quelque marchand de curiosités, d'où Louise Desbordes rapportait un de ces objets de matière somptueuse ou chatoyante, dont les belles tonalités évoquaient pour elle toute une suite d'harmonies colorées.
En 1879, elle exposait au Salon un panneau de fleurs intitulé : « Souvenir de première Communion ». Ce fut, tout de suite, le succès. Un critique qui ne fut jamais tendre ni complaisant, Joris-Karl Huysmans lui-mème — ce ne fut que beaucoup plus tard qu'ils firent connaissance — écrivit ces lignes : « Nous ne changeons pas de sujets, en abordant la nature morte. Pioupious d'Epinal ou fleurs de taffetas, c'est bon à mettre dans le même sac. Je fais exception pour Mlle Desbordes, qui brosse avec une belle énergie ses floraisons. Son « Souvenir de première Communion » est joliment peint. Toute cette gamme de blancs jouant sur du vert pâle est charmante ; puis, le voile jeté sur la coupe, les chapelets et le livre, donne un effet de nuée flottante très curieux ».
En 1880, un autre tableau de fleurs « La Fête de l'Absent » : sur une table, une mappemonde qu'une gerbe de fleurs caresse, un coffret entrouvert d'où s'échappent des lettres, une fleur encore, épinglée sur la sphère au point des mers lointaines où doit voguer l'aimé. Albert Wolf en parle ainsi dans le « Figaro » : premiers tableaux quelque chose de la précision des Hollandais, nous la verrons maintenant, de plus en plus, s'abandonner à sa nature, qui est de rêver : rêve harmonieux, irréel le plus souvent, où la couleur est toute-puissante... et si puissant, le talent ! De plus en plus, disparaîtront de ses compositions les accessoires trop délimités, comme cette sphère céleste du tableau intitulé « La nuit », dont Paul Mantz dit qu'elle est « un chef-d'œuvre d'exécution » qu'elle exposa en 1881, et qui fut acquis par Georges Petit : des fleurs, des fleurs encore... et entendez bien qu'on ne dira point d'elle, comme Jean Lorrain, je crois, parlant de Mme Madeleine Lemaire, qu'elle « fait la fleur comme Jeanny l'Ouvrière ».
Ses natures mortes ne sont pas matière à ces trop habiles trompe-l'œil dont tant d'artistes fort cotés ont abusé, qui se croyaient tous des virtuoses, et ne furent souvent que des pignocheurs elle, les amateurs de « sujets » seront déçus, et elle n'aura jamais les honneurs (?) de l'Almanach des Postes et Télégraphes... et cela lui est si parfaitement égal, le sujet, que bientôt les titres de ses tableaux n'auront pour elle qu'une fort minime importance, et qu'elle les intitulera le plus souvent, parce qu'il faut un nom au rédacteur du catalogue, « Fleurs ». Autour de ces fleurs, des eaux glauques, des lointains vaporeux, des poissons aux chatoiements de pierreries, des insectes précieux comme des gemmes ; à peine, de temps à autre, dans ces décors de féerie, une face humaine, toujours un peu fantômale et irréelle, lamentable Ophélie, Christ douloureux, Sirène dont les cheveux cuivrés s'apparentent aux algues...
Elle compose, réellement, au sens musical du mot, et souvent même après un préalable entraînement musical où elle s'est saturée d'effluves sonores : quelque part dans l'atelier invraisemblablement encombré de bibelots, de potiches, de broderies, de boudhas dorés et ventrus, de colliers de jade ou d'ambre enroulés par tout, au col des statues comme à celui des énormes grenouilles de céramique, accrochés aux chevalets, la tache colorée d'un de ces objets, caressé par un rayon de soleil, a frappé son regard... peut lui chaut que ce soit une babouche ou un samovar, un bijou ou une lanterne... c'est la note lumineuse qu'elle vient de percevoir qui sera le thème de son orchestration ; un accord, sur cette note, en majeur ou en mineur, suivant l'heure de son âme, lui fournira fugue et contre point... De cette tache, sur la toile, une fleur naît, lumineuse, éclatante ; et puis, tout autour, viennent s'harmoniser les tons, puissants ou atténués, sombres ou clairs, se faisant valoir, croirait-on, avec un étonnant instinct de la couleur, qui pourrait bien être, aussi, une science étonnante. Elle ne peint que ce qu'il lui plaît de voir, mais elle voit admirablement ce qui lui plaît, fut-ce en dehors de toute matérialité.
Car ce parti-pris de vague et d'irréel n'est jamais chez elle un vulgaire truquage pour masquer la paresse ou l'impuissance ; et quand il lui convient de faire un morceau, elle l'enlève en pleine pâte, quelquefois, ou quelquefois dans un travail précieux comme celui d'un laqueur chinois, avec une maestria, une virtuosité, où seule la main d'un très bon peintre peut atteindre. Après que la symphonie, sans plus, vous en aura séduit, regardez d'un peu plus près quelqu'un de ces étranges ragoûts de couleur, et vous serez étonné de voir quelles solidités ne décèlent sous cette facture apparemment lâchée... Je n'en prendrai pour preuve que ce panneau, précieusement conservé par Ch. Jouas, où une grosse carpe au ventre doré se joue sur un fond d'un bleu de nuit qui, de loin, pourrait passer pour uniforme : de près, il s'avère meublé de tout un mystérieux grouillement, par-delà des profondeurs…
Les connaisseurs ne s'y sont pas trompés : George Petit lui commande un plafond pour son hôtel ; Hector Pessard lui achète son Scarabée ; Daubigny considère comme une aubaine, d'échanger une toile avec elle. Sarah Bernhardt orne son atelier du « Songe de l'Eau qui sommeille » ; le baron Piérard, Georges Clairin, Thérèse Humbert, les collectionneurs les plus avisés de France et de Belgique, conservent ses toiles parmi leurs plus belles. Jean Lorrain, Loti, Huysmans, sont parmi ses amis les plus admiratifs.
Et c'est toute une longue carrière qui se déroule, pendant quarante-sept années :
En 1881, elle expose ce « Songe de l'Eau qui sommeille », dont je viens de parler, et avec lequel elle enlève brillamment sa première mention ; et le bon François Fertiault, ce poète qui était encore assez jeune à cent ans pour publier un volume de vers, s'en inspire pour un sonnet ; Drumont, dans la « Liberté », en goûte le charme « printanier et frais » ; Gabriel Vicaire envie le « Songe de l'Eau », et Paul Mantz déclare, dans le « Temps », qu'il est « impossible de peindre des fleurs plus vivantes et plus heureuses d'être au monde ».
En 1882, c'est « L'Automne » ; Camille Lemonnier écrit, avec son lyrisme un peu surchargé : « Depuis la splendeur glorieuse des pampres, incarnation des idées d'apogée, jusqu'à l'inquiétante aigreur des idées de lutte et de déchirement, elle en joue avec une virtuosité incomparable. Tout son art est dans ce clavier duquel elle tire à volonté des harmonies pleines et puissantes ou de lourds accords voilés, qui tour à tour expriment des sensations riantes ou funèbres, selon que sa mansuétude ou sa colère dispense autour d'elle la vie et la mort. L'âme des coloristes a seule ces grands secrets ».
A cette appréciation l'on peut joindre celle d'un critique alors écouté, Eugène Montrosier : « Mlle Louise Desbordes ne copie personne. Elle s'en tient à la nature qu'elle réchauffe à la flamme d'un des plus étonnants tempéraments que nous connaissions. Tout, dans ses compositions, respire à la fois la grâce, le parfum et la force. C'est une femme qui serait digne d'être un homme. Théodore Rousseau qui trouvait que les femmes « ne concluent pas », eût changé d'avis s'il eût connu Mlle Desbordes ». Péladan, de son côté, déclarait, au sujet des Poissons qu'elle exposait la même année : « Cette peintresse est un excellent peintre ».
En 1883, voici « Le Papillon et la Grenouille ». J'ai pu voir cette toile, retrouvée par Jouas chez un amateur. La grenouille et le papillon y sont bien, en effet, encore qu'on ne les voie pas tout de suite, tant on est séduit par l'effet général ; et ils sont traités avec cette science du « morceau » que j'ai déjà signalée ; mais ils sont là surtout pour justifier le titre de cette symphonie de blancs et de gris perle, d'une étourdissante habileté.
1884, et c'est le « Scarabée » qui a tenté Hector Pessard, et les « Libellules », achetées par G. Clairin, dont toutes les chroniques artistiques de l'époque vantent la fraîcheur.
En 1885, dans un numéro de la « Revue » dirigée par Charles Fuster, et où nous retrouvons, curieuse coïncidence, des poésies d'André Godard, nous lisons sous la plume de Jean-Paul Clarens, à propos de la participation de Louise Desbordes à l'Exposition de Bordeaux : « II passe dans sa peinture comme des effluves de mysticisme vaporeux et alangui. L'inutile et le banal sont absents de ses œuvres, caractérisées par une ordonnance irréprochable et un style étrange. La pensée même s'éprend de la conception idéale qui palpite sous cette flore bizarre et suggestive comme une toile de Gustave Moreau. On sent, dans cette indécision savante de la forme, sourdre un tempérament d'artiste exceptionnel ».
En 1886, sa « Barrière de Fleurs » lui vaut, enfin, la médaille de 2e classe, qu'elle eût obtenue depuis longtemps avec un peu plus d'entregent et beaucoup moins d'excessive modestie. En 1889, ses envois à l'Exposition Universelle sont récompensés d'une nouvelle mention.
Entrée en 1890 à la Société Nationale, avec ses magnifiques « Fleurs Exotiques », Louise Desbordes y exposa régulièrement depuis, tous les ans, sans rien perdre, avec le temps, de ses qualités originales ; ses dernières œuvres, celles même qu'elle y envoya en 1926, ne trahissent nulle décrépitude, nulle infériorité à elle-même. Dans les derniers mois de la maladie qui l'emporta, son plus grand regret fut de ne pas pouvoir s'asseoir à son chevalet, pour peindre encore…
Jusqu'à la fin aussi elle garda cette âme charmante, presque enfantine de fraîcheur, qui frappait tous, ceux qui l'approchaient. Et, ne pouvant plus extérioriser ses rêves sur la toile, elle se les chantait à elle-même : Tout près de sa fin, restée seule une après-midi, une voisine, par dessus le mur du jardinet sauvage de Créteil, l'entendit, bâtissant toute une féerie autour du balancement, dans l'air tiède, d'une branche de vigne vierge, se raconter un merveilleux et puéril dialogue, ou, d'une voix très douce, fredonner à mi-voix ses airs d'autrefois, ses airs d'opéra.
De nombreux groupements artistiques s'honoraient de compter Mme Louise Desbordes-Jouas dans leurs Sociétaires ; parmi les plus notoires nous devons citer les « Femmes Peintres et Sculpteurs », et l' « Eclectique », où ses envois étaient toujours appréciés, comme ils l'étaient à toutes ces Expositions de Province ou de l'Etranger, où ne lui manquèrent point des récompenses qu'elle n'eût point sollicitées.
L'Anjou peut être fier d'avoir donné le jour à cette très pure artiste, si merveilleusement pourvue des dons de la couleur et de l'harmonie, et dont la douceur et l'aménité étaient si bien apareillées à son ciel natal. Elle laisse derrière elle toute une œuvre dont, plus tard, les musées s'enorgueilliront.
A nous, ses camarades de la « Société des Artistes Angevins », nous reste le souvenir d'avoir eu parmi nous, vingt ans durant — depuis notre fondation —, toujours prête à prendre sa part de nos manifestations, cette artiste dont le talent nous honorait grandement, et cette femme aimable, si modeste, que nul n'en tendit jamais proférer un mot amer ou malveillant ; et nous demeure aussi cette précieuse recrue qu'elle nous avait amenée en la personne de Charles Jouas, qu'elle avait annexé à l'Anjou. Ce grand graveur, qui est plus qu'un graveur, un vrai peintre, nous permettra de penser qu'aujourd'hui plus que jamais il est des nôtres. Parmi nous il conservera, vivant, le témoignage de Celle qui n'est plus, et, qu'il avait si bien comprise.
Marc Leclerc.
Janvier 1927.
Une artiste angevine : Louise Desbordes-Jouas (1848-1926), par Marc Leclerc, éd. André Bruel (Angers), 1927, 16 p., en hommage à Louise Desbordes, peintre et chanteuse lyrique du XIXe-XXe siècle, membre de la Société des artistes angevins (notice BnF).
Marc Leclerc (1874-1946), écrivain angevin, créateur des rimiaux, poèmes ou contes rimés en langue angevine, peintre, conférencier, membre de la Société des artistes angevins.
Du même auteur : Rimiaux d'Anjou (dont Les Coëffes s'en vont, Cheuz nous, Veille de Fête, La pibole, En foère), Notre frère le poilu, Poètes angevins.
Littérature — Culture — Territoire — Patrimoine — Économie — Administrations — Documents