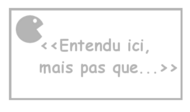Amiquié
En Anjou
- amiquié
Mot
Nom commun, féminin singulier. Ancien français devenu régionalisme.
En Anjou (Br), amiquié pour amitié. Le t est remplacé dans la prononciation de la syllabe ti faisant partie d'une diphtongue : amitié devient amiquié ou amikié.
Exemple : « Je sommes ben reconnaissants de toutes les preuves d’amiquié qu’on nous a données. » (Verrier et Onillon, Discours)
 Notes
Notes
- Voir aussi gâs, fernacul.
- Anatole-Joseph Verrier et René Onillon, Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou, Germain & Grassin (Angers), 1908, t. 1, p. 506 (et p. 374 du 2e t.)
- Hippolyte-François Jaubert, Glossaire du centre de la France, premier volume, Impr.-libr. Napoléon Chaix et Cie (Paris), 1856, p. 69
- Ancien theâtre françois, Collection des ouvrages dramatiques les plus remarquables depuis les mystères jusqu'à Corneille, tome X, Glossaire, P. Jannet libr. (Paris), 1857, p. 26
- Eugène de Chambure, Glossaire du Morvan, Dejussieu père et fils impr.-libr. (Autun), 1878, p. 25
- Gustave Le Vavasseur, Remarques sur quelques expressions usitées en Normandie, dans Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie, publié par l'Association normande, 45e année, F. Le Blanc-Hardel (Caen) et C. Metérite (Rouen), 1878, p. 128
- M. Court de Gebelin, Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne considérée dans l'histoire naturelle de la parole, ou Origine du langage et de l'écriture, Baudet Valleyre Duchesne Saugrain Ruault (Paris), 1775, p. 217
- Œuvres de Molière, Nouvelle édition, par MM. Eugène Despois et Paul Mesnard, tome sixième, Librairie Hachette et Cie (Paris), 1881, p. 69 (Le médecin malgré lui, acte II, scène I)