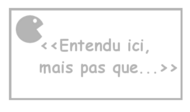« Par-sus » : différence entre les versions
m (aussi) |
(relecture) |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=== Mot === | === Mot === | ||
Préposition. Composé de ''par'' et de ''sus''. Ancien français devenu régionalisme. | Préposition. Composé de ''par'' et de ''[[sus]]''. Ancien français devenu régionalisme. | ||
En Anjou, ''par-sus'' (''parsus'') pour par-dessus. | En Anjou, ''par-sus'' (''parsus'') pour par-dessus. | ||
Exemple : {{citation|J’avais vu parler de queuque chouse parsus l’sahaies. }} (Verrier et Onillon, ''[[Discours du banquet du centenaire du lycée David-d'Angers|Discours]]'') | Exemple : {{citation|J’avais vu parler de [[queuque]] chouse parsus l’sahaies. }} (Verrier et Onillon, ''[[Discours du banquet du centenaire du lycée David-d'Angers|Discours]]'') | ||
=== Glossaire V. et O. === | |||
Dans le glossaire de Verrier et Onillon : {{citation|Par-sus (Mj., By.), prép. — Par dessus. | Dans le glossaire de Verrier et Onillon : {{citation|Par-sus (Mj., By.), prép. — Par dessus. | ||
Ex. : Il a déviré cul ''par-sus'' tête. | Ex. : Il a déviré cul ''par-sus'' tête. \\ Par-sus | ||
l'épaule gauche, formule ironique de négat. | l'épaule gauche, formule ironique de négat. | ||
ou de refus ; on l'accompagne du geste. | ou de refus ; on l'accompagne du geste. | ||
| Ligne 38 : | Ligne 39 : | ||
{{-DicoNotes-}} | {{-DicoNotes-}} | ||
* Voir aussi [[sus]], [[ | * Voir aussi [[sus]], [[dessur]], [[darière]], [[vers-me]]. | ||
* Anatole-Joseph Verrier et René Onillon, ''Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou'', Germain & Grassin (Angers), 1908, t. 2, p. 87-88 et [[Glossaire Verrier et Onillon - volume 2 - page 372|p. 372]] | * Anatole-Joseph Verrier et René Onillon, ''Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou'', Germain & Grassin (Angers), 1908, t. 2, p. 87-88 et [[Glossaire Verrier et Onillon - volume 2 - page 372|p. 372]] | ||
* Jehan de Bourdigné, '' | * Jehan de Bourdigné, ''Chroniques des pays d'Anjou et du Maine'', Nouvelle édition, Impr. Cosnier et Lachèse (Angers), 1842, p. 96 | ||
* D'Espinay, Notices archéologiques - XIII - L'abbaye de Saint-Nicolas-lès-Angers'', ''Revue historique, littéraire et archéologique de l'Anjou'', Nouvelle série illustrée, Septième année, Tome premier, Impr.-libr. E. Barassé (Angers), 1874, p. 122 | * G. D'Espinay, ''Notices archéologiques - XIII - L'abbaye de Saint-Nicolas-lès-Angers'', dans ''Revue historique, littéraire et archéologique de l'Anjou'', Nouvelle série illustrée, Septième année, Tome premier, Impr.-libr. E. Barassé (Angers), 1874, p. 122 | ||
* Claude Fabre de Vaugelas, ''Remarques de M. De Vaugelas sur la langue francoise avec des notes de Patru et T. Corneille'', Tome troisième, Didot (Paris), 1738, p. 326 | * Claude Fabre de Vaugelas, ''Remarques de M. De Vaugelas sur la langue francoise avec des notes de Patru et T. Corneille'', Tome troisième, Didot (Paris), 1738, p. 326 | ||
Dernière version du 7 janvier 2023 à 09:05
En Anjou
- par-sus, parsus
Mot
Préposition. Composé de par et de sus. Ancien français devenu régionalisme.
En Anjou, par-sus (parsus) pour par-dessus.
Exemple : « J’avais vu parler de queuque chouse parsus l’sahaies. » (Verrier et Onillon, Discours)
Glossaire V. et O.
Dans le glossaire de Verrier et Onillon : « Par-sus (Mj., By.), prép. — Par dessus. Ex. : Il a déviré cul par-sus tête. \\ Par-sus l'épaule gauche, formule ironique de négat. ou de refus ; on l'accompagne du geste. Et. — Composé avec Sus, comme le fr. Par dessus l'est avec dessus. — N'est jamais adv. — S'écrit qqf. en un seul mot, parsus. Hist. : « Puisque voyez que les dieux et Nature, M'ont par sus tous inclinée à lui plaire. » (G.-C. Bucher, 217, 216.) — « La voyez-vous enflée et glorieuse, De sa beauté par sus toutes eslue ! » (Id., 37, 100.) — « Retyrez-vous, satisffaictz au parsus. » (Id., 269, 249.) — « Mais je hay par sur tout un scavoir pédantesque. » (J. DU Bell., Les Regrets, p. 223.) — « Les eaulx furent si grandes en la rivière qu'elles passaient de touttes pars par sur la levée. » (1615. Inv. Arch., E, II, 302, 1.) — « Ce faict, tout à l'aise passa la jambe droite par sus la selle. » (Rab., G., I, 35, p. 70.) — « Ils ont passé le Rhein par sus le ventre des Suisses et des Lansquenets. » (Rab., G., I, 33, 66.) »
 Notes
Notes
- Voir aussi sus, dessur, darière, vers-me.
- Anatole-Joseph Verrier et René Onillon, Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou, Germain & Grassin (Angers), 1908, t. 2, p. 87-88 et p. 372
- Jehan de Bourdigné, Chroniques des pays d'Anjou et du Maine, Nouvelle édition, Impr. Cosnier et Lachèse (Angers), 1842, p. 96
- G. D'Espinay, Notices archéologiques - XIII - L'abbaye de Saint-Nicolas-lès-Angers, dans Revue historique, littéraire et archéologique de l'Anjou, Nouvelle série illustrée, Septième année, Tome premier, Impr.-libr. E. Barassé (Angers), 1874, p. 122
- Claude Fabre de Vaugelas, Remarques de M. De Vaugelas sur la langue francoise avec des notes de Patru et T. Corneille, Tome troisième, Didot (Paris), 1738, p. 326
- M. L. Lalanne, Oeuvres de Malherbe, Nouvelle édition, Tome cinquième, Libr. de L. Hachette et Cie (Paris), 1869, p. 621
- Henri Moisy, Dictionnaire de patois normand, Henri Delesques impr.-édit. (Caen), 1887, p. 613