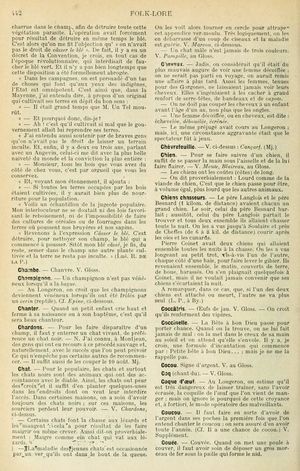Croyances et superstitions en Anjou (C-D)
|
charrue dans le champ, afin de détruire toute cette végétation parasite. L'opération avait forcément pour résultat de détruire en même temps le blé. C'est alors qu'on me fit l'objection qu' « on n'avait pas le droit de câsser le blé ». De fait, il y a eu un décret de la Convention, je crois, en tout cas de l'époque révolutionnaire, qui interdisait de faucher le blé vert. Et il n'y a pas bien longtemps que cette disposition a été formellement abrogée.
« Dans les campagnes, on est persuadé d'un tas de choses qui font qu'aux yeux des indigènes, l'Etat est omnipotent. C'est ainsi que, dans la Mayenne, j'ai entendu dire, à propos d'un original qui cultivait ses terres en dépit du bon sens :
« — Il était grand temps que M. Un Tel mourût.
« — Et pourquoi donc, dis-je ?
« — Ah ! c'est qu'il cultivait si mal que le gouvernement allait lui reprendre ses terres.
« J'ai entendu aussi soutenir par de braves gens qu'on n'avait pas le droit de laisser un terrain inculte. Et, enfin, il y a deux ou trois ans, parlant avec un Angevin, celui-ci me dit avec la plus belle naïveté du monde et la conviction la plus entière :
« — Monsieur, tous les bois que vous avez du côté de chez vous, c'est par orgueil que vous les conservez.
« Et, voyant mon étonnement, il ajouta :
« — Si toutes les terres occupées par les bois étaient cultivées, il y aurait bien plus de nourriture pour la population.
« Voilà un échantillon de la jugeote populaire. Mon interlocuteur ne se doutait ni des lois favorisant le reboisement, ni de l'impossibilité de faire des cultures de céréales ou de fourrages dans les terres où poussent nos bruyères et nos sapins.
« Revenons à l'expression Câsser le blé. C'est détruire, pour nettoyer son champ, le blé qui a commencé à pousser. Sitôt mon blé câssé, je fis, du reste, semer dans le champ une autre plante cultivée et la terre ne resta pas inculte. » (Lué. R. de LA P.)
Chambe. — Chanvre. V. Gloss.
Champignon. — Un champignon n'est pas vénéneux lorsqu'il a la bague.
— Au Longeron, on croit que les champignons deviennent vénéneux lorsqu'ils ont été frôlés par un vérin (reptile). Cf. Epine, ci-dessous.
Chanter. — Quand un petit enfant crie haut et ferme à sa naissance ou à son baptême, c'est qu'il sera beau chanteur.
Chardons. — Pour les faire disparaître d'un champ, il faut y enterrer un chat vivant, de préférence un chat noir. — N. J'ai connu, à Montjean, des gens qui ont eu recours à ce procédé sauvage et, naturellement, avec le succès que l'on peut prévoir Ce qui n'empêche pas certains autres de recommencer. — Il suffît aussi de les couper le 10 août. Mj.
Chat. — Pour le populaire, les chats et surtout les chats noirs sont des animaux qui ont des accointances avec le diable. Ainsi, les chats ont peur des "croix" et il suffît d'en planter quelques-unes dans les endroits dont on veut leur interdire l'accès. Dans certaines maisons, on a soin d'avoir toujours des chats noirs ; sur ces maisons, les sourciers perdent leur pouvoir. — V. Chardons, ci-dessus.
— Certains chats font la chasse aux lézards et les mangent et cela a pour résultat de les faire maigrir ou même crever. Aussi dit-on proverbialement : Maigre comme ein chat qui vat aux lézards.
— La maladie des jeunes chats est occasionnée par un ver qu'ils ont dans le bout de la queue.
On les voit alors tourner en cercle pour attraper cet appendice ver-moulu. Très logiquement, on les en débarrasse d'un coup de ciseaux et la maladie est guérie. V. Marcou, ci-dessous.
— Un chat mâle n'est jamais de trois couleurs. V. Pampille, au Gloss.
Cheveux. — Jadis, on considérait qu'il était du plus mauvais augure de voir une femme décoiffée ; on ne serait pas parti en voyage, on aurait remis une affaire à plus tard. Aussi les femmes, tenues pour des Gorgones, ne laissaient jamais voir leurs cheveux. Elles s'ingéniaient à les cacher à grand renfort de serre-têtes, de bandeaux et de capots.
— On ne doit pas couper les cheveux à un enfant avant l'âge d'un an, non plus que les ongles.
— Une femme décoiffée, ou en cheveux, est dite : échevelée, débouélée, écrênée.
— Le même préjugé avait cours au Longeron ; mais, ici, une circonstance aggravante était que le spectateur fût à jeun.
Chèvrefeuille. — V. ci-dessus : Cançarf. (Mj.)
Chien. — Pour se faire suivre d'un chien, il suffit de se passer la main sous l'aisselle et de la lui faire flairer. — V. Meute, Blaireau, au Gloss.
— Les chiens ont les coûtes (côtes) de long.
— On dit proverbialement : Lourd comme de la viande de chien, C'est que le chien passe pour être, à volume égal, plus lourd que les autres animaux.
Chiens chasseurs. — Le père Langlois et le père Besnard (1 kilom. de distance) avaient chacun un grand chien. Le soir, celui du père Besnard hurlait ; aussitôt, celui du père Langlois partait le trouver et tous deux ensemble ils allaient chasser toute la nuit. On les a vus jusqu'à Soulaire et près de Cheffes (de 6 à 8 kil. de distance) courir après les oies et les canards.
Pierre Coinet avait deux chiens qui allaient ensemble toutes les nuits à la chasse. On les a vus longeant au petit trot, vis-à-vis l'un de l'autre, chaque côté d'une haie, pour faire lever le gibier. Ils revenaient ensemble, le matin, couverts de terre, de boue, harassés. On s'en plaignait quelquefois à Coinet, mais il ne voulait jamais convenir que ses chiens s'écartaient la nuit.
A remarquer, dans ce cas, que, si l'un des deux chiens est attaché ou meurt, l'autre ne va plus seul (L. P., à By.)
Coccâtris. — Œufs de jau. V. Gloss. — On croit qu'ils renferment des vipères.
Coccinelle. — La Bête à bon Dieu passe pour porter chance. Quand on la trouve, on ne lui fait jamais de mal : on la met dans le creux de sa main au soleil et on attend qu'elle s'envole. Il y a, je crois, une formule d'incantation qui commence par : Petite bête à bon Dieu. . . ; mais je ne me la rappelle pas.
Cocou. Signe d'argent. V. au Gloss.
Coq (chant du). — V. Gloss.
Coque d'œuf. — Au Longeron, on estime qu'il est très dangereux de laisser traîner, sans l'avoir écrasée, la coquille de l'œuf que l'on vient de manger ; mais on ignore le pourquoi de cette croyance et, à fortiori, le mode opératoire des malveillants.
Coucou. — Il faut faire en sorte d'avoir de l'argent dans ses poches la première fois que l'on entend chanter le coucou : on sera assuré d'en avoir toute l'année. (Cf. Il a une chance de cocou.) V. Supplément.
Couée. — Couvée. Quand on met une poule à couver, il faut avoir soin de déposer un gros morceau de fer sous la paille qui forme le nid.
Courroie-nouée. — Il est d'un très mauvais présage de trouver un nœud fait accidentellement sur une des courroies qui servent à lier les bœufs. (Lg.)
Couteau. — On ne fait pas volontiers présent d'un couteau : ça coupe l'amitié. Le cas échéant, il faut, pour conjurer le maléfice, que le donataire remette un sou en échange du couteau.
Couvrâilles. Emblaisons. — Semailles. Au Longeron, les anciens tenaient qu'il ne fallait pas coiwrer quand les filandreaux étaient sur la terre ; mais il convenait de couvrer quand la bergère (bergeronnette) était sur le guéret. On ne tient plus compte de ces remarques.
Crache-de-cocou. — V. Gloss.
Cracher. — Il ne faut pas cracher dans le feu, cela rend poitrinaire.
Craîts (Envies). — Lorsque de petites languettes de peau se détachent et se soulèvent au bout des doigts, vers la racine des ongles, c'est que l'on grandit. Aussi les appelle-t-on : Craîts (craître, croître).
Crapaud. — Il est bon qu'il y ait un crapaud dans un puits, dans une fontaine : il ramasse le velin de l'eau. — V. Bouc. — Méthode recommandée aux savants de l' Institut-Pasteur. — V. Boursier, au Gloss.
— On croit que les crapauds et les serpentes tettent parfois les vaches, qui ont alors les tétines en sang et dont le lait tourne. — V. Crapaud, au Gloss.
— « On faisait courir le bruit qu'on avoit trouvé en sa maison un pauvre saulnier emmainoté de quantité de crapauds morts et vifs. Le premier estoit assez à croire ; mais les uns l'affirmoient et accusoient ledit Grandet de magie, autres l'atténuoient et disoient que les crapaux secs, appliquez sur un charbon pestilenciel, attirent le venin jusques à crever ; autres disoient qu'un pescheur de grenouilles vida son sac, pour le remplir de ce qu'il pouroit attraper du pillage. » (Cél. Port., Inv., p. 436.)
N. — Il règne ici, au sujet de ces batraciens, une croyance très répandue. On s'imagine que, lorsqu'un crapaud boursier fixe une personne, en faisant de la bouche ce mouvement d'aspiration et de déglutition qui lui est habituel, il lui suce le sang de loin, même à travers ses sabots (sic).
Crêpes. — Lorsqu'on mange des crêpes le jour de la Chandeleur, on n'a pas la fièvre de toute l'année. (Lm.)
Crieux. — Le crieur de La Perraudière. (Lué.) « Les bruits qu'on entend la nuit dans les campagnes sont propices à la formation des légendes, surtout quand ils ont qqch. de bizarre et de mystérieux. C'est ainsi que les vols d'oies sauvages, mêlant de clameurs, semblables à des aboiements de chiens lointains, le bruissement de leurs ailes, ont été l'origine de la croyance à la Chasse ou Menée Hennequin.
« A Lué retentit qqf. dans les bois un cri de nature très particulière et vraiment effrayant. C'est, disent ceux qui l'ont entendu, comme le râle d'une personne qu'on étranglerait, et cela se termine par un éclat de rire diabolique. Les amateurs du merveilleux ont trouvé de suite un nom pour désigner l'auteur nocturne de ce hurlement sinistre : c'est le Crieux de la Perraudière. Quant à savoir ce que c'est que ce crieur, mystère ! On a voulu prétendre qu'il ne se manifestait que lorsque le Saint-Sacrement n'était pas à la chapelle du château ; mais il a été entendu dans des circonstances qui infirment radicalement cette opinion. Les septiques et ceux qui cherchent toujours des explications naturelles disent que ce sont tout simplement des cris de blaireau, animal plutôt taciturne dans l'habitude de la vie. Cependant, un vieux garde disait : « Je connais le cri des blaireaux, mais ce n'est pas la même chose que celui du Crieux de la Perraudière, que j'ai aussi entendu. » Le plus grand nombre n'a pas connaissance du Crieux et n'a jamais eu les oreilles frappées de ce cri étrange. Mais, à défaut d'autre légende locale, celle-ci, tout embryonnaire qu'elle soit, nous a paru digne d'être notée. » (R. de la Perraudière.)
Croix. — La croix, naturellement, tient une grande place dans les croyances semi-religieuses, semi-superstitieuses de nos populations.
— Le laboureur ne commence jamais à semer son grain sans faire le signe de la croix.
— On n'entame pas un pain sans avoir tracé, avec la pointe du couteau, une croix sur la face inférieure.
— Lorsqu'un décès survient dans la famille d'un meunier, les ailes du moulin, sont mises en croix, deux verges verticales et deux horizontales. IV. Mort, au n° II du Folk-Lore.
— A Montjean, quand on conduit un défunt à l'église et au cimetière, un homme précède le convoi, portant de petites croix de bois qu'il a fabriquées avec des baguettes fendues et il en plante une à chacun des carrefours par où passe le cortège.
— Quelques croix passent pour avoir des vertus particulières. Ainsi, à Montjean, la croix de Montauban, où les mères apportent les petits enfants d'une lieue à la ronde pour les faire courre. Une condition indispensable de réussite, c'est que le pèlerinage ait lieu le premier vendredi du mois et non un autre jour.
— On croit fermement que les chats, bêtes diaboliques, comme chacun le sait, ont peur des croix. Aussi en plante-t-on dans les melonnières, pour les empêcher de manger les melons, et sur les tas de grains des greniers (voir Chat), pour qu'ils n'y déposent pas leurs orduires.
— Un chapelet qui a perdu sa croix est un chapelet de sourcier : on est persuadé que les sorciers ne font usage que de semblables chapelets.
— Les conjureurs font un grand usage du signe de la croix dans leurs incantations. Ainsi, pour guérir une foulure de poignet, il suffit de tracer avec le pouce quatre signes de la croix sur la partie blessée en prononçant la formule mnémonique : Anté et anté, super et anté.
— Il n'est pas jusqu'aux enfants qui dans leurs jeux ne fassent usage du même signe. Lorsque la bille d'un des joueurs se dirige trop évidemment vers le but, l'adversaire s'empresse de tracer au devant sur le sol, une ou plusieurs croix, pour la détourner. C'est ce qu'ils appellent faire : la croix du diable.
— Il ne faut pas, quand on s'aménage, mettre les lits en croix avec les soliveaux, il y aurait mort dans l'année. — Ne pas mettre les barges en croix dans la cour, ça porte malheur au bétail.
Darue (la) (Sal.), s. f. — Bête fantastique. — Prendre la darue. — Quand un étranger, d'une intelligence peu éveillée, vient dans nos régions, des jeunes gens lui proposent d'aller « prendre la darue ». Ils le conduisent dans quelque fourré, lui mettent en main une chandelle allumée, c.-à-d. un « falot » et une poche. — « Couche-toi dans les broussailles, ouvre la poche grande devant toi, pose le « falot » à côté, regarde bien et ne bouge plus ; nous allons faire les rabatteurs. » — Ils s'éloignent, font d'abord qq. bruit dans les fourrés voisins, puis disparaissent, laissant le « nigaud ».
Extrait de l'ouvrage de A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers de l'Anjou : comprenant le glossaire proprement dit des dialogues, contes, récits et nouvelles en patois, le folklore de la province, Germain & Grassin (Angers), 1908, tome second — Troisième partie : Folk-Lore, III Croyances — Superstitions — Préjugés, pages 442 et 443, Casse-pierre à Darue. Publication en deux volumes.
Croyances et superstitions de Verrier et Onillon :
- • Croyances et superstitions en Anjou (A-C).
- • Croyances et superstitions en Anjou (C-D).
- • Croyances et superstitions en Anjou (D-L).
- • Croyances et superstitions en Anjou (L-P).
- • Croyances et superstitions en Anjou (P-R).
- • Croyances et superstitions en Anjou (R-V).
- • Croyances et superstitions en Anjou (V-V).
Littérature — Culture — Territoire — Patrimoine — Économie — Administrations — Documents