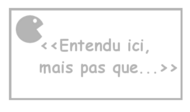Fripe
En Anjou
- fripe
Mot
Nom commun, féminin singulier.
En Anjou, fripe pour ce qui se mange sur le pain.
Exemple : « Aussi, faut point qu’on s’étonne que j’y mettions ben du soin : j’aimons ben qu’ nout’ frip’ sey’ bonne, et pour ça, j’avons besoin de prend’ conseil ed parsonne ! » (M. Leclerc, Rimiaux d'Anjou)
Glossaire V. & O.
Dans le glossaire de Verrier et Onillon : « Fripe (Sp., By., etc.), s. f. — Tout ce qui se mange sur le pain. Syn. de Fricot. \\ Friandises : beurre, crème, confitures.
N. — GÉNIN, Récréat. philolog. I, 409. « La frippe était. . . de la friandise, beurre, crème, confiture. » Voilà de la frippe, terme aujourd'hui vivant en Anjou. (Et il cite un passage de Balzac : Eugénie Grandet.) — Grandet dit à Nanon qu'il y aura suffisamment de pain... « D'ailleurs, ces jeunes gens de Paris, tu verras que ça ne mange point de pain. — Ça mange donc de la frippe ? dit Nanon. » — En Anjou, la frippe, mot du lexiq. popul., exprime l'accompagnement du pain, depuis le beurre étendu sur la tartine, frippe vulgaire, jusqu'aux confitures d'alberge, la plus distinguée des frippes. Et tous ceux qui, dans leur enfance, ont léché la frippe et laissé le pain comprendront la portée de celte locution. » — TALLEMANT dit de Mme de Puisieux : « Jamais il n'y eut une si grande friande... Elle endetta le couvent des Dix-Vertus d'une somme considérable, et cela pour des friponneries, car le pâtissier seul demanda beaucoup. » — Je vois dans TRÉVOUX que des boîtes de cotignac d'Orléans s'appelaient des fripons. Cela s'explique tout seul par l'étymol. fripe, mais il paraît difficile d'en rendre raison à l'aide des fripiers. — (Précédemment. GÉNIN avait écrit : ) « A propos de fripiers, je trouve dans l'ouvrage de M. Louis DELATRE (Des rapports du français avec le sanscrit). . . une explication du mot fripon que je crois absolument fausse : « Fripon, dans l'origine, désignait un homme couvert de fripes, ou guenilles ; même racine que fripier. » — Oui (dit GÉNIN), même rac. que fripier, j'y consens, mais non pas à ce que fripe ait jamais signifié guenille, ni fripon un homme déguenillé. » — SCHELLER pense friper aurait pour acception originelle chiffonner, de là gâter par usure, consumer, enfin : manger goulûment. »
 Notes
Notes
- Voir aussi friper, frigousse, roucher, piâcher.
- Anatole-Joseph Verrier et René Onillon, Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou, t. 1, Germain & Grassin (Angers), 1908, p. 411
- Marc Leclerc, Rimiaux d'Anjou - Sixième édition, Au bibliophile angevin André Bruel (Angers), 1926, p. 20 (def. rimiau)
En français, fripe, populairement, tout ce qui se mange. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)