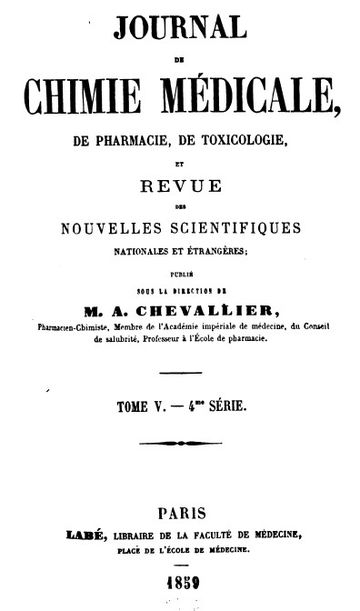Histoire des pharmaciens d'Angers de 1474 à 1800
|
Nous eussions vivement désiré de pouvoir présenter à la Société académique un travail complet sur les pharmaciens d'Angers, travail d'ensemble qui eût été d'autant plus intéressant pour cette partie de l'histoire locale que jusqu'ici nul ne l'a voulu tenter ; mais, dès les
- (1) Nous reproduisons l'article ci-joint, qui ne fait qu'augmenter le regret que nous éprouvons de ne pas voir publier une histoire de la pharmacie et des pharmaciens, ou des apothicaires, comme le disent encore certaines personnes.
premiers pas, nous nous sommes heurté, dans nos recherches, contre des obstacles qui ne paraissent pas devoir être jamais surmontés. J'indiquerai particulièrement la confusion qui exista longtemps entre les deux professions, si distinctes de nos jours, de pharmacien et d'épicier, et qui a fait que nos annales, imprimées ou manuscrites, les réunissent habituellement sous le même nom de marchands ou marchands épiciers, surtout de 1400 à 1600, et ne nous permettent ainsi de reconnaître qu'un nombre évidemment trop borné des hommes qui exercèrent la pharmacie.
Cette confusion dans la désignation de professions si différentes était d'ailleurs provoquée par l'existence de règles communes à leur exercice, assimilation qui, au point de vue légal, était surtout motivée sur ce que les marchands épiciers, pour s'approvisionner de leurs marchandises, entretenaient à peu près seuls alors des relations régulières avec les pays étrangers, d'où ils recevaient en même temps directement les drogues médicinales, qui commençaient généralement à passer ainsi tout d'abord entre leurs mains. Aussi, à Paris, et par suite dans plusieurs grandes villes, les deux professions ne formèrent-elles qu'un seul corps, composé des apothicaires et des épiciers, avec cette différence entre elles, toutefois, que, si l'apothicaire avait le droit de faire le commerce des épiceries, l'épicier, lui, ne pouvait composer de remèdes qu'après avoir été reçu apothicaire. Cette sorte de promiscuité subsista jusqu'à la suppression des jurandes, que vint prononcer l'édit de 1776. Du reste, la profession d'apothicaire avait commencé d'être réglée spécialement dès 1484, sous Charles VIII, et fut successivement réglementée avec plus d'étendue sous Louis XII, François ler, Charles IX, Henri III, Henri IV, etc.
On doit, au surplus, remarquer que cette dénomination d'apothicaire avait été précédée par celle de pharmacien, et que ce ne fut qu'à la révolution de 89 que le titre de pharmacien vint reprendre sa place.
A cette époque de rénovation sociale et de remaniement général, avec la maîtrise disparurent aussi toutes les minutes des actes, tous les documents officiels qui se rattachaient à l'exercice de la pharmacie dans notre ville : si bien que nous ne pouvons plus guère espérer aujourd'hui d'en pouvoir reconstituer l'histoire, en voulant rester strictement fidèles à la vérité des faits, qu'en glanant avec plus ou moins de bonheur les renseignements épars dans les chroniques locales, les traditions de nos pères et quelques actes privés qui ont pu échapper aux atteintes du temps et au vandalisme des guerres civiles.
C'est seulement dans l'année 1550 qu'il nous est permis de trouver un point de départ pour constater la place que par leurs lumières, leur caractère, leur patriotisme, leurs opinions religieuses ou politiques, les services rendus à leurs concitoyens, certains de nos prédécesseurs avaient pu prendre parmi les hommes influents de la ville.
Ainsi qu'on le sait, la nôtre fut l'une des premières où furent accueillies avec ardeur les doctrines du protestantisme. Une bonne partie de la population embrassa avec chaleur le parti de la réforme, et l'on remarque parmi les disciples les plus fervents de la foi nouvelle plusieurs pharmaciens qui, jurant de la propager au péril de leur vie et de leur fortune, abandonnèrent momentanément le pilon héréditaire pour saisir l'arquebuse et l'épée, se laissant aller d'autant plus aisément à l'entraînement du moment qu'ils s'y voyaient précédés ou accompagnés par plusieurs membres distingués du haut clergé.
C'est ainsi que, le 4 avril 1561, Claude Dupineau, dit la Masse, chanoine de la cathédrale d'Angers, dont depuis longtemps on suspectait l'orthodoxie, mais qui, à raison de son mérite et de son caractère personnel, n'en jouissait pas moins d'une grande influence parmi ses concitoyens, ayant abjuré, réunit pendant la nuit, à son domicile, ses partisans, pour organiser le pillage des églises. Bon nombre d'apothicaires répondirent à son appel. Le sieur Grimaudet, ayant la qualité de droguiste, laquelle l'on voit ici pour la première fois apparaître dans nos annales, fut nommé son lieutenant.
Les huguenots restèrent maîtres de la ville ; mais, pour s'opposer à leur entreprise, le maire et les échevins avaient formé une garde de 500 arquebusiers, divisés par sections, dont chacune était chargée de veiller à l'une des portes de la ville, dont les huguenots voulaient s'emparer.
A la porte Saint-Nicolas, le capitaine La Bellotière et son lieutenant Jehan Cotte-Blanche, apothicaire, bons catholiques et vaillants soldats, défendirent ce poste important. C'est sans doute à l'énergie qu'il montra en cette occasion, et aux bons sentiments dont il fit preuve, que le dernier dut d'être nommé plus tard juge au tribunal de commerce en 1573, puis député aux États le 6 décembre 1576, où il demanda avant tout l'unité religieuse. Jehan Cotte-Blanche est le premier pharmacien catholique dont l'histoire de notre pays ait conservé le nom. Il a mérité à plus d'un titre cette mention honorable, et aurait pu servir d'exemple à beaucoup d'autres en ces temps de troubles.
L'année suivante (14 juillet 1562), les huguenots furent obligés de quitter la ville, chassés par les catholiques. 244 habitants furent condamnés à mort par contumace, et parmi eux 9 apothicaires. Ce sont : Nicolas Fouquère, Pierre du Grap, Jean Les Doisseaulx, Gilles Les Doisseaulx, Mathurin Godeville, d'Huisseau, Jehan Gillet, Gilles et François Chopin. Mais un autre confrère dont le nom n'a pas été conservé, moins heureux, fut arrêté, et le 24 du même mois, jour de vendredi, un couturier et ce confrère, convaincus d'hérésie et de sédition, furent pendus place Neuve.
Il y avait donc au moins cette année-là dix pharmaciens qui exerçaient dans la ville, car ceux que les années retenaient chez eux ne durent pas prendre une part active à la révolte, et la chronique a dû les passer sous silence.
Cette réduction dans le corps des apothicaires ne fut pas du reste de longue durée, car le mercredi 7 avril 1563, par suite de la publication de la paix, quelques huguenots revinrent dans leurs foyers, et quelques-uns des nôtres durent aussi profiter de l'armistice ; mais ce ne fut définitivement que le 15 janvier 1564, et après avoir guerroyé et pillé le pays environnant, qu'ils rentrèrent tous, sans toutefois vouloir abjurer et en restant fidèles à leurs croyances.
Cette trêve avait amené un peu de repos ; le commerçant, fatigué et ennuyé de porter l'arquebuse, songea à son négoce, et cette année même eut lieu l'établissement de nos premiers juges consuls, formant le Tribunal de commerce. En parcourant la liste des apothicaires, on voit que nos confrères y siégèrent fréquemment, acquérant ainsi de nouveaux droits à la considération publique.
Toutefois, la paix était plus apparente que réelle, car les catholiques et les huguenots, pendant les années suivantes, surent se faire une guerre sourde, sans en venir aux armes. Les catholiques, plus puissants, mais non pas plus modérés, et aveuglés par leur influence et le désir de se venger, faisaient pendre tout individu soupçonné d'hérésie. Aussi François Chopin, apothicaire, sur un simple soupçon (le 30 août 1572), fut-il condamné comme hérétique ; la sentence toutefois ne fut pas exécutée, car nous le retrouvons juge consulaire en 1583.
Non-seulement presque tous les apothicaires de l'époque acceptèrent les idées de la réforme, mais ils inculquèrent à leurs enfants les mêmes convictions et le même esprit d'indépendance et d'égalité, qui en était la conséquence. L'on voit en effet qu'en 1573, la femme du procureur du roi, Cochelin, fille de feu Claude Haran, sieur de La Garde, vivant marchand apothicaire, se fit remarquer, cette année, avec quelques dames de ce temps, en portant en publie le chaperon de velours, à la manière des demoiselles nobles. Aussi Bodin observe-t-il que « ces roturières, en franchissant la barrière que le temps et l'usage avaient élevée entre la noblesse et la roture, contribuèrent peut-être plus que de firent leurs maris, dans la magistrature et dans la milice bourgeoise, à accélérer la marche de la grande révolution. »
Certainement, l'éducation que nos pères recevaient et faisaient donner à leurs enfants était acceptée comme un besoin ; car les moines, qui avaient la prétention d'être seuls instruits, devaient nuire aux intérêts du corps médical, et il serait curieux de rechercher quelles pouvaient être alors les connaissances que les moines gardaient si précieusement.
On ne peut guère douter que quelques-uns d'entre eux, bons simplistes, ne connussent la pharmacie pratique aussi bien que nos confrères qui avaient pignon sur rue, et certes quelques-uns d'entre eux devaient faire une concurrence sérieuse aux marchands de la ville, car aucune loi, aucun règlement, ne leur défendaient l'exercice de l'apothicairerie pour leur communauté d'abord, et pour le public ensuite : aussi dom Alexandre, frère apothicaire bénédictin, publiait-il, en 1750, un dictionnaire de botanique et de pharmacie qui eut un grand succès, et dont les éditions se succédèrent sans interruption.
Mais, à sa porte, la communauté des apothicaires avait encore à se défendre du droguiste, qui empiétait sur ses droits ; aussi nous retrouvons une première sentence de la Cour prévôtale d'Angers (21 avril 1610) qui défend à un sieur Mareau, droguiste, de faire la pharmacie, bien que notre maîtrise ne fût pas encore obtenue.
Quelques années plus tard, en 1615, l'administration de la ville avait été obligée de créer, sous le titre d'Hospice des pauvres, une maison spéciale destinée à loger et à soigner les nombreux pauvres qui parcouraient les rues ou stationnaient au milieu des places, en demandant l'aumône et implorant des secours pour se guérir. Un appel fut fait à tous les pharmaciens ; chacun d'eux, à tour de rôle, fut obligé de fournir les drogues nécessaires au service des chirurgiens, et aucun des nôtres ne faillit à ce devoir.
L'histoire de la corporation et de quelques pharmaciens a été peu étudiée ; cependant les différentes phases par lesquelles nous avons passé, et que nous venons de voir, méritaient à plus d'un titre de fixer l'attention. Il est bon que nous sachions que nos pères, qu'ils aient été catholiques ou huguenots, n'ont laissé aucune tache dans nos annales. Quand ils furent suffisamment fatigués de guerroyer, ils songèrent enfin à s'unir et à déterminer les bases et les règles de leur profession dans l'intérêt de leurs successeurs.
Le premier acte, qui prouve la bonne confraternité qui existait alors entre les pharmaciens, est un premier projet d'association à la date de 1618. Voulant se réunir par un règlement sérieux, et laissant de côté toute discussion religieuse, ils formèrent dès lors une corporation ; mais, jusqu'à ce jour, ils n'avaient joui d'aucun des privilèges accordés à une profession qui, autant qu'aucune autre, méritait certainement de fixer l'attention, ou plutôt le bon vouloir du juge prévôtal de notre bonne ville.
Louis XIII prit en considération la demande qui fut faite par la corporation des maîtres apothicaires, et leur accorda leurs premières lettres patentes en janvier 1619, sur la demande du sieur Urbain Gabriel Goupil, maître apothicaire, demeurant place Neuve, lequel avait certainement consulté les règlements de la maîtrise de Paris, qui, ainsi, avait seule précédé la nôtre de près d'un demi-siècle.
Lettres patentes de Sa Majesté, vérifiées et homologuées suivant l'arrêt de Nosseigneurs de la Cour du Parlement de Paris.
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut :
« Nos chers et bien-aimés apothicaires de nostre ville d'Angers, nous ont fait dire et remonstrer, que pour obvier aux abus et alversations qui se pourroient commettre audit art en ladite ville, ils ont, le 13 janvier 1618, dressé entre eux certains articles et statuts concernant ledict art, qui ont été trouvés justes et nécessaires pour le bien public de ladite ville, par nostre prévost, juge ordinaire et garde de la police d'icelle. Mais pour ce que l'ordre estably par lesdicts articles et statuts se pourroit anéantir par le temps s'ils n'étoient pas par nous agréés et approuvés, ils nous ont fait supplier leur en vouloir accorder la confirmation. A ces causes, après avoir fait voir en nostre conseil lesdicts articles et statuts, ensemble l'acte et jugement du prévost de ladite ville, estant au bas desdicts statuts de xxiij janvier, le tout cy attaché sous le contre scel de nostre chancellerie. De l'avis d'iceluy nostre dict conseil et de nos certaine science, pleine puissance et authorité royale, avons, iceux articles et statuts, comme justes, utiles et nécessaires, agréés, confirmés et approuvés, agréons, confirmons et approuvons par ces présentes, voulons et nous plaist qu'ils soient ores et à l'advenir, suivis, gardés et observés de point en point selon leur forme et teneur, par lesdicts maîtres apothicaires et leurs successeurs audict art, sans qu'il y soit contrevenu en façon quelconque. Si donnons en mandement à nostre seneschal d'Anjou, ou ses lieutenants, prévost, juge ordinaire et garde de la police audict Angers, et à tous autres nos justiciers et officiers et à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que ces présentes il fasse registrer et de tout leur contenu, ils faient, souffrent et laissent jouir et user lesdicts maistres apothicaires et leurs successeurs audict art pleinement, paisiblement et perpétuellement, contraignant à l'observation desdicts articles et statuts tous ceux qu'il appartiendra, car tel est nostre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autry en tout.
« Donné à Paris, février 1619, et de nostre règne le 9e.
« Signé : RENOVARD.
« Par le Roy. Visa. CONTENTOR et DESPORTES.
« Et scelé du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte. »
La communauté des pharmaciens dut être satisfaite de voir qu'on avait accepté son règlement en son entier.
L'histoire nous a encore conservé le nom d'un autre apothicaire de cette époque, de Jean Besnard, lequel devint plus tard échevin de la ville, et il est probable que, comme beaucoup d'autres, il approuva la demande qui avait été présentée par son confrère. Il y avait déjà alors environ quarante-deux ans que la maîtrise de Paris était instituée. Les apothicaires de Tours, La Rochelle, Angers, ne firent donc que suivre cet exemple, voulant surtout empêcher l'exercice de leur profession par les étrangers. A cette époque, la chimie n'était pas encore, à proprement parler, une science, et les formules que les chirurgiens envoyaient chez les pharmaciens étaient hérissées de signes cabalistiques inconnus du public, dont les alchimistes se servaient journellement pour décrire leur caput mortuum, leur crapaud, la colombe, etc., en désignant par règne ou relation chaque opération qui leur présentait un aspect particulier. Cependant des curieux cherchaient à lever le voile qui couvrait ces opérations mystérieuses, et finissaient parfois par en découvrir le secret qu'ils s'empressaient de livrer à la connaissance du public. C'est ainsi que l'on vit arriver à Angers (en 1623), rue Saint-Michel, et descendre à la Rose-Rouge, un alchimiste qui avait le don de faire croitre en vingt-quatre heures, dans un vase de verre ou de cristal, un arbre d'or ou d'argent, appelé l'arbre végétatif des philosophes.
Je pense que les pharmaciens, pour faire voir le même miracle, comme on l'appelait, placèrent sur leurs devantures la même préparation, et que, de nos jours, on pourrait encore retrouver cel arbre relégué dans quelque coin obscur des anciennes officines, comme on y trouve différents vases de formes particulières portant pour inscription le nom de certaines préparations qui étaient placées à l'intérieur, ou bien encore l'ancienne chevrette (pot de faïence à bec) dans laquelle nos aïeux mettaient leurs sirops et leurs opiats.
De tout temps le pharmacien a placé sur sa devanture des serpents ; nos timbres, nos livres en portent encore l'empreinte : c'était l'attribut d'Esculape et le symbole de la prudence, et il ne faut pas s'étonner si nos anciens allaient jusqu'à suspendre à leur plancher des peaux de serpents bourrées. Il en fut toutefois quelques-uns qui, rejetant ces souvenirs du paganisme, mettaient leurs maisons sous la protection d'un saint qu'ils affectionnaient d'une manière particulière. Ainsi saint Christophe, avec une belle figure, bien taillée et peinte par un des meilleurs sculpteurs de France, décorait la façade de la boutique du sieur Thibouce, maître apothicaire, demeurant au quarroy de la porte Chapelière, au logis de Jehan Lecompte, qui l'y avait fait placer dès l'année 1550. D'autres, plus simples, affectionnaient le véritable mortier, l'emblème matériel de leur profession, et le décoraient de fleurs de lis, de croix de Malte et de l'inscription suivante, qu'on peut encore lire aujourd'hui sur certains :
La médecine ne se contentait pas de nos opiats, de nos électuaires : car en 1625 plusieurs personnes firent usage de l'eau ferrugineuse de la fontaine de l'Epervière. Dès 1623, l'administration de la ville pria Hubert (Pierre), apothicaire, ainsi que plusieurs médecins, de s'assurer par eux-mêmes de la vérité et de la vertu de cette eau. Ils allèrent visiter la fontaine le 8 août 1624, et un an plus tard les mêmes personnes (le 4 août 1625) se rendirent de nouveau sur le tertre de l'Epervière, non plus pour s'assurer de l'existence de la fontaine, mais bien pour étudier la nature de ses eaux et rechercher les terres qu'elle pouvait contenir. Nous devons regretter de ne pas connaitre la rédaction de ce procès-verbal et ses conclusions, qu'on ne retrouve plus, bien qu'il eût été imprimé à Angers.
Si jusqu'ici nous avons eu surtout à signaler parmi nos confrères, d'après ce que nous en ont appris nos chroniques, des partisans religieux et politiques animés d'une humeur aventureuse ou guerroyante, nous rencontrons aussi quelques hommes plus modestes et qui se plaisent à concentrer leur activité dans l'accomplissement du plus généreux des devoirs de leur profession. Nous indiquerons particulièrement un sieur Dugrat, qui vivait en 1626. Homme instruit, paraît-il, jouissant d'une fortune noblement acquise, et animé d'un amour ardent pour sa ville et pour le soulagement de l'humanité souffrante, apothicaire et père des pauvres de l'hôpital Saint-Jean, on le vit successivement juge aux marchands et échevin. Ce fut lui qui acheva de ses propres deniers la promenade près le portail Lyonnais, d'où l'on avait la vue de la Maine. « Le 6 août 1626, dit une chronique manuscrite, pour prouver sa bonne affection et amitié aux habitants de la ville d'Angers et particulièrement aux paroissiens de la Trinité, il fit établir deux religieux récollets du couvent de la Baumette au faubourg Saint-Lazare, afin d'assister les malades frappés de la peste et contagion, leur administrer les saints sacrements et aussi procéder à l'enterrement de ceux qui meurent de la maladie, et ce à défaut de MM. les curés de ladite paroisse, qui ne veulent aller voir et assister les malades. »
Bien que les lettres patentes délivrées aux apothicaires d'Angers portassent qu'elles étaient accordées aux marchands, maîtres apothicaires-épiciers, les deux professions étaient distinctes cependant dans notre ville, où chacune avait son règlement particulier, tout en étant de la même maîtrise. La distinction entre les deux professions n'excluait pas d'ailleurs la bonne intelligence entre ceux qui les exerçaient, car on ne rencontre pas un seul arrêt contre le corps des épiciers ; mais diverses sentences furent rendues contre les droguistes et les chirurgiens de la ville d'Angers et de Durtal au profit de la maîtrise, et nous citerons à cet égard :
- 1° Sentence de la sénéchaussée d'Angers du 31 décembre 1688, au profit des maîtres apothicaires, contre le sieur Buret, droguiste ;
- 2° Sentence de la sénéchaussée d'Angers du 30 août 1692 contre le même ;
- 3° Sentence de la sénéchaussée d'Angers du 27 avril 1693, qui ordonne au sieur Bault, droguiste, de faire visiter ses marchandises, et contre le sieur Blain, droguiste ;
- 4° Sentence de la sénéchaussée d'Angers du 19 juillet 1745, qui prononce le bien-jugé d'une sentence de la prévôté d'Angers du 2 mars 1744, et défense au sieur Gabriel Silord et aux chirurgiens de la ville de faire mixtion de drogues, seulement pour les maladies vénériennes, lesquelles drogues seront prises chez les apothicaires ;
- 5° Sentence de la sénéchaussée d'Angers, le 30 mai 1757, contre le sieur Jau, chirurgien, condamné à 3 livres d'amende au profit de la maîtrise.
Toutefois, cette querelle entre l'apothicaire et le chirurgien ne fut pas, paraîtrait-il, de longue durée, et doit étonner d'autant plus que nos lettres patentes nous obligeaient à faire instruire nos serviteurs et élèves par un chirurgien bien famé. Ainsi, pendant la première année d'apprentissage, c'était le chirurgien qui devait faire la lecture à l'élève dans un livre de bonne apothicairerie, deux fois par semaine, dans la pharmacie du maître. Ce n'était pas un simple acte de complaisance : nos statuts l'exigeaient.
Chaque année la maîtrise nommait un doyen, un procureur, un syndic et deux gardes-jurés. Les noms de ceux qui remplirent ces fonctions sont arrivés jusqu'à nous. Le garde-juré était chargé d'empêcher les étrangers de débiter des drogues, d'éviter toute malversation des deniers de la communauté et de conserver les archives.
Nous ne connaissons que 10 pharmaciens qui furent reçus par la maîtrise. Ce sont :
- Salmon, exerçant à Beaufort en 1755 ;
- Claude Lemaire, exerçant à Durtal en 1763 ;
- Perraud, exerçant en 1763 ;
- Coustard père et son fils ;
- Pierre Belon ;
- Chaillin, exerçant à Baugé ;
- Jean-Charles Ollivier, reçu le 9 juin 1767 ;
- Pierre Roujou, reçu le fer juillet 1783 ;
- Goupil fils ;
- Faulcon et Pain, exerçant à Saumur.
Cette liste n'est pas complète, mais si la maîtrise a reçu des pharmaciens, elle doit avoir reçu aussi deux pharmaciennes : madame Rivière, femme Villaton, pharmacienne au bourg d'Iré, et madame Claudine Cahoreau, dans la même localité (1), lesquelles auraient obtenu leur diplôme après trois années d'exercice. Malgré l'autorité de l'Annuaire, ce fait peut paraitre extraordinaire, puisque la maîtrise n'accordait pas de titre aux femmes, et encore moins les jurys médicaux qui lui ont succédé.
Si notre maîtrise n'a pas reçu un grand nombre de pharmaciens, elle en a du moins fourni un qui adressa le 21 mars 1671, à l'administration de la ville, une demande d'immunités et de priviléges qu'aucun de nous ne pourrait adresser aujourd'hui, fondée sur ce qu'il avait 19 enfants vivants ! Le sieur Michel Desmazières, maître pharmacien, et Pierre Goubault, chirurgien (ce dernier, sans doute, un des aïeux de Simon Goubault l'apothicaire), adressèrent de semblables demandes.
Dans cette même année parut la Pharmacie galénique et chimique de Moïse Charas, apothicaire, appartenant à la religion réformée. Ce traité était généralement suivi à Angers, car on en retrouve encore dans le commerce de la librairie toutes les éditions avec le nom des pharmaciens qui en étaient propriétaires.
Ce fut en 1672 que l'on nous accorda la maîtrise, qui vint remplacer
- (1) Voy. l'Annuaire de 1811, p. 186.
la communauté des pharmaciens. Il fallut dès lors que les maîtres et les apprentis payassent à l'hospice général la somme de 6 livres, à titre d'aumône aux pauvres. Mais si certaines charges pesaient sur la caisse commune, l'instruction devint en 1753 plus facile pour les jeunes serviteurs des pharmaciens. L'on voit que la Faculté de médecine, qui tenait ses séances aux grandes écoles, chaussée Saint-Pierre, chargea un de ses professeurs de faire un cours d'histoire naturelle et de pharmacie. Nous étions obligés au reste, comme toutes les autres corporations, d'assister à la Fête-Dieu, et le rôle signé par le garde des Gardes nous fait connaitre qu'en 1757 les sieurs Jacques-François Bouester de la Touche, Joseph Coustard, ancien garde ; Joseph Proust, Charles-Jacques Berger, demeurant au coin de la rue du Godet ; Jean Monnier, Claude-Simon Goubault, Louis-Jean-Baptiste Raimbault, habitant place du Pilori, n° 5, et Jacques Pelletier, tous gardes-jurés ou anciens gardes, représentaient la maîtrise à cette procession. Si parmi les nôtres nous avons eu des calvinistes, nous pouvons donc nous vanter aussi d'avoir eu de bons catholiques comme de bons pères de famille.
Si nous passons en revue les vingt-six articles qui composent notre règlement, nous voyons que, tout en sauvegardant l'intérêt général, nos pères n'avaient point du reste oublié leur intérêt particulier, lorsqu'ils exigeaient de leurs élèves un travail sérieux pendant dix années d'études passées sous leurs yeux ; il fallait en outre qu'ils eussent fait leurs humanités, afin de traduire facilement le latin plus ou moins moderne de la formule du chirurgien.
Le droit de recevoir les pharmaciens était le droit le plus important. Pour se conformer à l'usage reçu, il fallait que l'aspirant fit prévenir les maîtres-jurés par un sergent, lorsqu'il se disposait à passer ses examens, à peu près à l'époque de la Saint-Nicolas d'hiver. Alors, en présence de deux chirurgiens notables pris dans la Faculté d'Angers et acceptés par la compagnie, l'aspirant subissait son premier examen, appelé la lecture, chez un des gardes-jurés ; puis l'acte des herbes, qu'il passait en herborisant aux environs. L'acte des herbes accompli, il fallait faire un chef-d'œuvre de quatre compositions, et, après ces épreuves, le candidat accepté par la compagnie versait dans la caisse de la communauté un marc d'argent (environ 54 fr. de notre monnaie) pour subvenir aux frais de la communauté, somme qui était divisée ici comme ailleurs en trois portions : l'une pour le roi, une autre pour le service des messes et frais de la confrérie et du métier, une troisième somme qui était attribuée aux gardes-jurés pour leurs peines et leurs vacations.
Une fois les frais soldés, le candidat était présenté par les deux chirurgiens et les gardes-jurés au juge prévôtal de la ville pour prêter le serment solennel des apothicaires chrétiens et craignant Dieu, à savoir : « Jurer de composer toutes poudres de bonnes et saines épices, de faire loyalement tous les actes du métier, sans y mettre aucunes fournitures non pertinentes. »
Les empoisonnements qui signalèrent, en France, la moitié du XVI° siècle, firent voir que la police de la pharmacie avait besoin d'être complétée. Aussi, à partir du 11 janvier 1759 et par suite de l'arrêt de la Cour du Parlement de cette date qui condamne Barbe Leleu, de Noyon, à être brûlée vive pour avoir empoisonné plusieurs personnes, il fut enjoint aux apothicaires d'inscrire désormais sur leurs registres le nom de ceux à qui ils vendaient de l'arsenic.
Nous savons qu'en 1777 il n'était pas possible, sans être reçu dans les formes que nous avons indiquées, de venir à Angers s'établir pharmacien à l'aide de lettres patentes particulières, comme cela se faisait encore cette année-là à Paris, et que quelques pharmaciens reçus à Paris exerçaient déjà la pharmacie au milieu de nous.
Le nombre des pharmaciens a peu varié en raison des mouvements de la population.
Nous en trouvons, en 1562, 10 ; en 1757, 9 ; en 1788, 10 ; en 1790, 11 ; en 1793, 9.
Dans ce nombre, il en est plusieurs qui se livraient avec succès à des travaux scientifiques ; mais l'absence de journaux spéciaux faisait que chacun était contraint de garder par devers lui ce qu'il savait. Ils éprouvèrent donc d'autant plus le besoin de se réunir pour s'éclairer et se soutenir mutuellement dans leurs études, et fondèrent une Société de médecine et de pharmacie en 17... Déjà plusieurs d'entre eux avaient accepté le titre de fondateurs de la Société des botanophiles. Proust, Roujou père, contribuèrent comme les autres, de leurs deniers, à l'établissement du premier jardin botanique du faubourg Bressigny.
Telle était la position de la pharmacie angevine lorsque survint la Révolution française, et elle ne fut pas la dernière de nos corporations à y prendre part. Les sieurs Pelletier, Goupil père et fils, et Coustard, signent l'adresse qui demandait à l'administration départementale la formation d'un bataillon de volontaires pour être adjoint au 1er bataillon que commandait Beaurepaire, et aller combattre avec lui les armées étrangères. Parmi les volontaires qui furent envoyés dans la Vendée se trouvait le fils d'un pharmacien d'Angers, Guitet, qui fut fait prisonnier à Cholet, le 14 octobre 1793, par les Vendéens, et traduit devant un conseil de guerre présidé par le général d'Autichamp. Chargé d'interroger le prisonnier et apprenant qu'il était le fils de Guitet l'apothicaire, le juge improvisé lui dit : « Je n'ai point oublié votre père, c'est un honnête homme. » Et le jeune prisonnier eut la vie sauve.
Guitet, rendu ainsi à sa famille, passa à l'hôpital militaire de Nantes, puis alla faire la guerre d'Espagne. De retour à vingt-quatre ans, il fut nommé pharmacien en chef de l'hôpital de Cholet ; puis enfin il vint remplacer son père dans son officine et dans la place de pharmacien des hôpitaux d'Angers. Pendant sa longue carrière dans cette profession, le fils se montra toujours et dans toutes les circonstances digne du père, dont la réputation de probité avait protégé sa jeunesse.
Nos annales nous ont conservé les noms de ceux de nos confrères qui ont rempli les premières charges de la maîtrise, et nous les indiquerons dans la liste des pharmaciens que nous donnerons ci-après, plus tard ; mais, avant de clore ces notes, nous croyons devoir consacrer ici une mention plus étendue à Jean-Charles Ollivier, qui fut le dernier des représentants de l'ancien corps des pharmaciens d'Angers.
Issu d'une famille honorable qui avait longtemps habité le quartier de la Trinité, il avait un frère aîné, médecin estimé et habile chirurgien, qui fut attaché en cette dernière qualité à l'hôpital militaire de la Trinité en 1789. Quant à Jean-Charles, une vocation impérieuse l'appelait à l'étude de la chimie et de la pharmacie, qui commençaient dès lors à être plus étroitement liées. C'était un homme d'un extérieur agréable, d'une taille élevée, au regard fin et intelligent. Il suivit, à Paris, les cours de Rouelle l'aîné, démonstrateur au Jardin du Roi et le prédécesseur de Fourcroy, cours sous lequel se révélèrent et se posèrent en quelque sorte les bases de la chimie moderne. Sous ce maître, qui tenait alors le premier rang parmi les promoteurs de la science nouvelle, il reçut les premières leçons des sciences naturelles et chimiques, et de leur application à la pharmacie. Acceptant comme la vérité tout ce que la parole du maître venait lui apprendre, il tenait exactement note de ses improvisations. C'était un de ces élèves que les maîtres affectionnent toujours : ardents à s'instruire, tourmentés du besoin de se rendre compte de tout ce qu'on leur enseigne, et les attendant au passage à la sortie des cours pour en obtenir de nouvelles explications.
Rouelle n'a pas publié son cours, mais son élève avait recueilli avec une exactitude extrême ses leçons orales, et les avait annotées de précieuses observations. Il parait que le maître manifestait un certain dédain pour les préparations pharmaceutiques qui se faisaient avec des substances animales, et que, sans tenir en grande estime les travaux et les idées des alchimistes, il ne niait pas absolument la possibilité de la transmutation des métaux, se fondant sans doute sur ce que, les métaux n'étant que des corps composés, la proportion des corps simples qui entrent dans leur composition, venant à varier, pouvait, en modifiant leurs combinaisons, changer la nature et l'apparence du métal.
Ollivier revint donc dans sa ville natale avec des idées neuves, bien différentes de celles des autres pharmacopoles, idées qu'il ne cessa d'étendre et de modifier, depuis lors, par des études constantes et personnelles. Ce fut dans cet esprit de critique et de progrès qu'il avait annoté toutes les préparations du Coder, en y joignant incessamment un grand nombre de remarques claires et judicieuses ; et nous ferons remarquer, à cette occasion, que, si l'on croit généralement que nos prédécesseurs avaient une très-grande quantité de préparations en vogue, c'est une erreur : car le Codex de cette époque était beaucoup plus restreint que le nôtre ; seulement, les recettes étaient plus compliquées et plus longues à exécuter.
Non-seulement Ollivier étudiait la pharmacie avec succès, mais il connaissait aussi les langues vivantes, l'anglais, l'italien, et l'on ne peut s'étonner de ce qu'avec une pareille éducation, supérieure alors à celle de tous ses confrères, il dût s'attirer d'une façon toute particulière l'estime et la considération du public. On voit en effet qu'il fut nommé garde en 1771, procureur en 1772, sous-aide-major dans la milice bourgeoise en 1778, avec le grade d'enseigne, et capitaine de la 5e légion en 1790.
En 1778, il avait fait revenir son fils de Paris, et l'avait établi rue Saint-Aubin. Lié d'amitié avec David père, il avait fait faire par celui-ci la boiserie de sa pharmacie en chêne sculpté.
Jusqu'à ses derniers instants, il s'occupa de son officine, et mourut âgé de quatre-vingt-cinq ans, vers 1817. Il resta donc longtemps le dernier représentant des pharmaciens reçus par la maîtrise.
Pharmaciens qui ont exercé à Angers depuis 1562 jusqu'en 1800.
- 1562. Nicolas Fouquère.
- 1562. Pierre du Grap, consul près le Tribunal de commerce en 1620, juge en 1627.
- 1562. Jean Les Doisseaulx.
- 1562. Gilles.
- 1562. Mathurin Godeville.
- 1562. ***, pendu place Neuve.
- 1562. Jehan Cotte-Blanche, député au tiers-état en 1576, juge en 1573, lieutenant dans les arquebusiers gardant la porte Saint-Nicolas, en 1562.
- 1562. François Chopin, soupçonné d'hérésie en 1572, juge consulaire en 1583.
- 1621. Jean Besnard. 1624. Thibouce.
- 1625. Dugrat, échevin de la ville, père des pauvres de l'hôpital Saint-Jean, au quarroy de la Trinité, près la rue de la Tannerie.
- 1625. Pierre Hubert, qui s'occupa de la fontaine de l'Épervière.
- 1671. Michel Desmazières, père de 19 enfants.
- 1753. Claude Haran, qui maria sa fille au procureur du roi Cochelin.
- 1757. Jacques-François Bouester de la Touche. 1757. Claude-Jacques Berger, rue du Godet, père des pauvres en 1753, ancien garde-juré en 1757.
- 1757. Jacques Pelletier, mort à quatre-vingt-dix-neuf ans, rue Saint-Étienne.
- 1757. Simon Goubault, garde-juré en 1757, syndic en 1769.
- 1757. Louis-Jean Raimbault, place du Pilori, n° 5, ancien garde en 1769.
- 1757. Joseph Proust, reçu le 26 fructidor an XIII ; conseiller municipal en 1791, notable en 1790, et associé botanophile en 1797.
- 1757. Joseph Coustard, garde en 1757, juge consulaire en 1779, et administrateur des hospices la même année, procureur en 1782, membre du conseil municipal en 1802.
- 1757. Jean Monnier, garde en 1757.
- 1763. Perraud, reçu par la maîtrise en 1763.
- 1763. Claude Lemaire, reçu par la maîtrise en 1763.
- 1763. Urbain-Gabriel Goupil, juge consulaire en 1763 et 1783 ; ancien garde-juré, un des fondateurs de la Société botanophile. 1769. Pierre-René Guitet (successeur de Berger), administrateur des hospices en 1766, procureur en 1769, demeurant devant le puits de la Trinité.
- 1769. François Nau, juge consulaire en 1743. Réélu de nouveau, son élection fut annulée le 6 mars 1752. Renommé en 1753, doyen en 1769.
- 1770. Jean-François Jubin, garde en 1772.
- 1772. Simon-Claude Goubault, garde-juré en 1772, capitaine de la garde en 1778.
- 1772. Jean-Charles Ollivier, reçu à Angers le 9 juin 1767, garde juré en 1771, procureur en 1772, sous-aide-major dans la milice en 1778, avec grade d'enseigne ; capitaine de la légion en 1790.
- 1790. Goupil jeune, notable et ancien juge en 1790, conseiller municipal en 1791.
- 1790. Goubault ainé, place Sainte-Croix, syndic en 1790.
- 1790. Coustard fils, reçu à Angers le 8 juin 1773, rue Saint-Laud ; membre du bureau de charité pour la ville d'Angers en 1790 ; notable.
- 1790. Pierre Roujou, reçu à Angers le 1er juillet 1783 ; un des fondateurs de la Société de chirurgie et de pharmacie, en 1798 (an VI de la République).
- 1790. Azema, porte Chapelière. 1790. Pierre Belon, reçu à Angers le 6 septembre 1790, rue Beaurepaire, puis rue Saint-Nicolas,
- 1793. Bellanger, rue de la Constitution.
Statuts et règlements des marchands, mattres apothicaires-épiciers de la ville d'Angers, concédés par lettres-patentes de Sa Majesté ; vérifiées et homologuées suivant l'arrêt de Nosseigneurs de la Cour du Parlement de Paris (14 décembre 1629).
- ARTICLE ler. Les médecins de la dite ville d'Angers ont de tout temps accoustume faire la leçon aux serviteurs et apprentifs de l'estat d'apothicaire et eslisent deux d'entr'eux tant pour faire leçon que pour assister aux actes, examens et visites.
- II. Les apprentifs dudit estat doibvent entendre la langue latine et faire trois ans d'apprentissage en la maison d'un des maistrés de la dite ville sans discontinuation.
- III. Les dits apprentifs ne se doibvent présenter à la Maîtrise qu'ils n'ayent atteint l'aage de 25 ans et exercé le dit estat dix ans continus en la dite ville ou autre bonne ville du royaume, compris sur le dit temps les dits trois ans d'apprentissage.
- IV. Aucun aspirant ne peut être reçu ni se présenter à la maîtrise qu'il n'ayt fait son apprentissage en la dite ville. Et où il prétendrait l'avoir fait ailleurs, est tenu servir les maistres de la dite ville par quatre ans sans discontinuation.
- V. Aucun ne se doibt présenter à la Maîtrise que au préalable perquisition n'ayt été faicte de ses bonnes vie et meurs, et s'il n'est trouvé attainct d'aucune notte d'infamie, il n'est reçu à se présenter à la dite maîtrise.
- VI. Peuvent les veufves des maistres apothicaires de la dite ville, pendant leur viduité, tenir boutique et exercer la pharmacie.
- VII. Ne peuvent les dictes veufves faire ny tenir aucun apprentif pour espérance d'estre reçu à la dicte maîtrise.
- VIII. Ne doibvent les dictes veufves tenir aucun serviteur qu'au préallable il n'ayt été matriculé par les quatre jurés du dict estat, lequel serviteur des dites veufves ne doibt mixtionner aucune composition qu'il n'ayt appelé les dicts jurés pour voir la dispensation.
- IX. Les serviteurs qui n'auront pas fait apprentissage en la dite ville et qui demeureront chez les dites veufves, sont obligez servir les dites veufves par le temps de huit ans avant que se présenter à la maîtrise.
- X. Chacun serviteur apothicaire demeurant chez l'un des maistres de la dite ville, ne doibt aller demeurer chez aucun maistre d'icelle sans sa permission, et advenant le decebs de l'un des dits maistres, son apprentif peut parachever le temps de son apprentissage chez un autre des dits maistres.
- XI. L'on ne doit recevoir qu'un seul aspirant à se présenter à l'examen, mais s'il est envoyé à certain temps pour n'avoir esté capable, en ce cas un autre aspirant se pourra présenter audit examen.
- XII. Tout aspirant à la maîtrise, ayant accomply ce que dessus, doibt présenter sa requeste aux quatre maistres jurez qui lui donneront jour, pour estre par deux divers jours ouy et interrogé par eux et par les autres maistres particuliers de la ville, en présence de deux docteurs en médecine députés de leur faculté, et ce en la maison de l'un des jurés.
- XIII. Les dits jurés sont tenus faire advertir par un sergent les autres maistres, du jour par eux donné et ce à la dilligence et frais de l'aspirant.
- XIV. L'aspirant ayant été interrogé et trouvé capable, luy sont donnés chefs-d'æuvre par les dits quatre jurés, de quatre compositions, quinze jours après le dict examen fait.
- XV. L'aspirant pendant les dicts actes est tenu con vier la dicte communauté pour herboriser et recognoistre s'il cognoit les simples.
- XVI. L'aspirant doibt faire bien et deüement les dits chefs-d'æuvre ès et saisons deües et convenables, et estre interrogé sur iceux par les dicts jurés et austres maistres particuliers, en présence desdicts deur médecins et la compagnie convoquée comme à l'examen. Et sont les dits actes faicts en la maison des dicts jurés.
- XVII. Après ces dits chefs-d'æuvre approuvés et reçus, est l'aspirant présenté par lesdicts deux docteurs en médecine et lesdicts quatre jurés, au juge prévostaire en ladicte ville, pour l'assurer de sa capacité, et lui faire prester le serment, et avant ladicte prestation de serment, est tenu l'aspirant, mettre es-mains du Procureur de la communauté un marc d'argent pour subvenir aux affaires de ladicte communauté.
- XVIII. Lesdicts maistres-apothicaires de ladicte ville ont de coustume de s'assembler une fois l'année, pour eslire à la pluralité des voix, deux de leur communauté pour jurés et gardes dudict estat en la place de deux qui sortent audict temps et accompagner les deux anciens qui demeureront qui font le nombre de quatre jurés, qui prestent le serment pardevant ledict juge prévostaire, de bien et deüement faire ladicte charge. Et ne doivent estre nommés pour juges, sinon ceux qui ont tenu boutique par quatre ans accomplis.
- XIX. Se faict visite deux fois l'année es boutiques des maistres particuliers et des veufves de la dicte ville par les quatre jurés, en la présence des deux docteurs en médecine esleus de leur faculté. Laquelle visite faicte, en est faict rapport au juge prévostaire.
- XX. Nul ne doibt exposer en vente aucun médicament, tant intérieur qu'extérieur, qu'il n'ayt été veu et visité par les dicts quatre jurés, en présence du doyen en la faculté de médecine en la dicte ville.
- XXI. Aucun soit marchand espicier, droguiste, confiseur et austres tenant boutiques en la dicte ville ne peuvent exercer la médecine et exposer en vente aucun thériaque mytridate, confections d'alchermès, hyacinthes et autres semblables compositions ne aucunes drogues, qu'elles n'ayent été visitées par les dicts jurés, pour éviter l'abus qui se pourroit commettre.
- XXII. Le marchand forain amenant en la dicte ville et faulxbourgs d'icelle, drogues et austres marchandises concernant le dict état d'apothicaire, ne les doibt exposer en vente, qu'elles n'ayent été veues, et visitées par lesdicts jurés aussi pour éviter abus, lesquels jurés advertissent les aultres maistres avant que d'achepter les dictes marchandises. Et est la dicte visite faicte dans les 24 heures après que le dict marchand forain s'est présenté aux dicts jurés.
- XXIII. Ne peuvent pareillement aucuns serviteurs d'apothicaires lever boutique n'y exercer la pharmacie aux fauxbourgs de la dite ville d'Angers qu'ils n'ayent aussi suby l'examen et chefs-d'œuvre et faict les autres charges ci-dessus.
- XXIUI. Ne peuvent les maistres apothicaires des autres villes du royaume lever boutique en la dicte ville d'Angers, et es fauxbourgs n'y y exercer le dict estat sans subir d'examen et faire les chefs-d'euvre et les autres charges ci-dessus.
- XXV. Ne peuvent pareillement tous apothicaires des champs du ressort d'Anjou ou il n'y a maistrise, lever boutique, qu'au préalable ils n'ayent obéi à l'arrest donné de nos seigneurs de la Cour au profit des docteurs régens en la faculté de médecine en l'Université de Paris le 17 décembre 1597, sans espérer aucun droict de prérogative touchant la maistrise de la dicte ville.
- XXVI. Ne peuvent les pères des aspirants, frères, oncles et austres leurs proches parents donner jour ni chef-d'œuvre, ni avoir voix délibérative pour la réception des dicts aspirants. Et s'ils sont jurés, ils se démettent de leurs charges de jurés, pour en estre par la communauté esleu d'austres, pour vacquer aux actes des dicts aspirants leurs parents.
Notes pour servir à l'histoire des pharmaciens d'Angers, de 1474 à 1800, par Charles Ménière, pharmacien à Angers, dans Journal de chimie médicale de pharmacie, de toxicologie, et revue des nouvelles scientifiques nationales et étrangères publié sous la direction de A. Chevalier, tome V, 4me série, Librairie de la Faculté de médecine (Paris), 1859, pages 618 à 638. Publication en série imprimée de 1825 à 1876 (notice BnF).
Sur le même sujet : Séance du 6 avril 1859 de la Société académique de Maine-et-Loire.
Autres documents :
La peste noire en Anjou en 1348,
Livre des tournois (1451),
Les regrets de Du Bellay (1558),
Les six livres de la République (1576),
Vocation cavalière de Saumur,
Crocodile du Muséum,
Dictionnaire de Viollet-le-Duc (1856),
Proverbes par de Soland (1858),
Exercice de la pharmacie (1859),
Société industrielle d'Angers (1858),
Villégiature à Angers au XIXe siècle,
Indicateur de Millet (1864),
Mémoires de la Société académique (1865),
Usages de Maine-et-Loire (1872),
Dictionnaire de Port (1874-1878),
Bulletin de la Société des sciences de Cholet (1883),
Notice de Milon (1889),
Glossaire de Verrier et Onillon (1908),
L'Anjou historique (1909),
L'Anjou et ses vignes de Maisonneuve (1925).
Littérature — Culture — Territoire — Patrimoine — Économie — Administrations — Documents