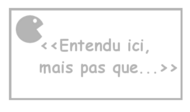Jardrin
En Anjou
- jardrin
Mot
Nom commun, masculin singulier, jardrins au pluriel.
En Anjou, jardrin pour jardin, lieu dans lequel on cultive des légumes, etc.
Exemple : « Is sont trop trist’s, les cem’tières plats coum’ des jardrins d’ notaires, trop neufs et trop ben rangés. » (M. Leclerc, Rimiaux d'Anjou)
Mot que l'on trouve aussi en pays Nantais et en Normandie.
Verbe correspondant, jardriner. Et, jardrinage pour jardinage.
Glossaire V. et O.
Dans le glossaire de Verrier et Onillon : « Jardrin (Mj., Sp., Lg., By.), s. m. — Jardin. Et. — Corr. du mot fr. par épenthèse d'un r, comme dans le fr. Perdrix, du lat. Perdicem ; Chanvre, du lat. Cannabira ; Trésor, de Thesau- rum, etc. Cf. Sardrine, pour Sardine. — Mot vieilli. — Qqf., l'r remplace un l ; coronel, pour colonel. — Le breton a pris ce mot : Jardrin.
Hist. — « Aveu rendu à la baronnie de Chalonnes. . . par René de la Jumellière, pour son hostel, court, douves, jardrins et cloustures de la Jumellière. » (1455. Inv. Arch., G., p. 14, 2.) — « Je me suis adventuré, En noz jardrins suis entré. » (Chanson du XVe s. — L. C.) — « Item une croix, ung calice d'argent doré et autres joyaux, que aucuns desd. sieurs du Chapitre avoient caché en un certain endroit du jardrin. » (Inv. Arch., G, II, 208, col. 1, 1569.) — « Estre es jardrins des nymphes Hespérides Et ne cueillir ny violettes ny fleurs. » (G.-C. Bûcher, 146, 170.) — « Loin des jardrins, vignobles et vergiers. » (Id., 257, 244.) — « S'ensuit le marchié fait avecques Jehan Patart et Jehan Gaudin, pour le grant jardrin du chasteau. « (1453. — Marché fait par MM. de la Chambre des Comptes d'Angers, pour les jardins du roi René au château des Ponts-de-Cé. — P. Marchegay, p. 11.) — « Le 6 novembre en la présence du magister à l'issue des vespres, marchande aux massons de Turcan la muraille du jardrin. » (1458. — Inv. Arch., G, 207, 2, m.) »
 Notes
Notes
Parler angevin
- Charles-Louis Livet, Un sonnet en patois angevin (XVIIe siècle), dans la Revue de l'Anjou et de Maine et Loire, troisième année, tome deuxième, Libr. de Cosnier et Lachèse (Angers), p. 128
- Charles Ménière, Glossaire angevin étymologique comparé avec différents dialectes, Lachèse et Dolbeau (Angers), 1881, p. 203
- Anatole-Joseph Verrier et René Onillon, Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou, t. 1er, Germain & Grassin (Angers), 1908, p. 496
- Marc Leclerc, Rimiaux d'Anjou - Sixième édition, Au bibliophile angevin André Bruel (Angers), 1926, p. 42 (déf. rimiau)
Autres régionalismes
- Louis Du Bois, augmenté par Julien Travers, Glossaire du patois normand, A. Hardel éditeur (Caen), 1856, p. 198
- Georges Vivant, N'en v'la t'i' des rapiamus ! Patois du pays nantais, Reflets du passé, R. et M. Vivant éditeurs (Nantes), 2015