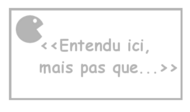Musse
En Anjou
- musse
Mot
Nom commun. Ancien français devenu régionalisme.
En Anjou (Cho, Stp, Lue, Mj, Lg, By), musse
- passage étroit dans une haie, un mur ;
- cache.
Un hameau à l'ouest de Saint-Georges-des-Gardes porte le nom de Grande-Musse.
Verbe correspondant, musser, passer dans un passage étroit.
Glossaire V. et O.
Dans le glossaire de Verrier et Onillon : « Musse (Z. 55, 69, Cho., St-P., Lue, Craon,
Mj., Lg., By.). — Passage étroit dans une
haie, un mur. V. Mucer. \\ V. Estomac. \\ Où
passe le lapin, y a du poil à la musse. — prov.
signifiant qu'on en est pour ses frais, qu'on
éprouve une perte, qu'on : laisse des plumes,
dans une affaire. \\ La Musse, est une localité
près de Nantes. \\ Prov. :
— J'ai ben vu la musse au lièvre,
Mais le lièvre n'y était pas.
Le chasseur a bien aperçu le lièvre ou le
lapin, mais, s'il y a « du poil à la musse », il
en conclut que l'animal n'est pas loin de son
terrier. (Lrm.) \\ Sal. — On dit aussi Guiche.
Et. — Le comte Jaubert tire ce mot de Mus,
souris, rat ; se glisser comme un rat. — Eveillé :
« Avant les démolitions de Paris, il existait dans
cette ville la rue du Petit-Musc, une des plus anciennes
de la cité, dont le nom, modifié d'âge en
âge, était arrivé à cette forme singulière. Au
moyen âge, la malice populaire lui avait donné le
nom de Pute-y-musse, parce qu'elle servait de
refuge aux nombreuses filles de joie du Val
d'Amour. »
Hist. — G.-C. Bucher, 113, 148.
« Voulant Gylon estouffer une puce
Qui menait guerre à son bel estomac,
Et ne pensant qu'on la vist à la muce,
Son sain descouvre et mect la puce à sac. »
— Villon, Ballade à Vamye :
« Orgueil mussé, qui gens met au mourir. » »
 Notes
Notes
Parler angevin
- Charles Ménière, Glossaire angevin étymologique comparé avec différents dialectes, dans Mémoires de la Société académique de Maine-et-Loire, t. XXXVI, Lachèse et Dolbeau (Angers), 1881, p. 442
- René de La Perraudière, Le langage à Lué, dans Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers, 5e série – t. VII, Germain & G. Grassin impr.-édit. (Angers), 1904, p. 147
- Anatole-Joseph Verrier et René Onillon, Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou, t. 2, Germain & Grassin (Angers), 1908, p. 50
- Jeanne et Camille Fraysse, Folklore des troglodytes angevins, impr. Farré et fils (Cholet), 1962, p. 14
- Dominique Fournier, Mots d'galarne : dictionnaire pour bien bagouler notre patois aujourd'hui, Cheminements (Le Coudray-Macouard), 1998, p. 56
- Pierre-Louis Augereau, Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire, Cheminements (Le Coudray-Macouard), 2004, p. 69
Autres régionalismes
- Henri Beauchet-Filleau, Essai sur le patois poitevin, ou Petit glossaire de quelques-uns des mots usités dans le canton de Chef-Boutonne et les communes voisines, L. Clouzot (Niort) et Ch. Moreau (Melle), 1864, p. 178
- Georges Vivant, N'en v'la t'i' des rapiamus ! Patois du pays nantais, Reflets du passé, R. et M. Vivant éditeurs (Nantes), 2015
Ancien français
- Thresor de la langue francoyse tant ancienne que moderne, t. 2, 1606
- Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, édition de F. Vieweg (Paris), 1881-1902, vol. 5, p. 458 et 437