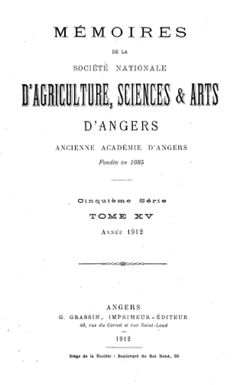Défense du patois angevin par A.J. Verrier
|
Défense et illustration du patois angevin[1]
- « Lingua majorum, pars patriæ. »
Ce n'est pas sans hésitation, sinon sans scrupule que j'ai emprunté à JOACHIM DU BELLAY le titre de l'un de ses principaux ouvrages. J'ai pensé, toutefois, que l'illustre Angevin de Liré, loin de se courroucer de mon audace, sourirait plutôt bienveillamment à cette idée d'un compatriote se plaçant ainsi sous sa protection et essayant de défendre le patois de sa petite patrie angevine, comme il avait, lui jadis — et avec quel talent ! — défendu et illustré le langage de sa grande patrie française.
Et lui-même ne m'encourage-t-il pas à plaider la cause du patois angevin dans le passage suivant ?
« Quant au reste, use de mots purement françois, non toutefois trop communs, non point aussi trop inusitez, si tu ne voulois quelquefois usurper, et quasi comme enchasser ainsi qu'une pierre précieuse et rare, quelques mots antiques en ton poëme, à l'exemple de VIRGILE, qui a usé de ce mot olli pour illi, aulai pour aulæ, et autres. Pour ce faire te faudroit voir tous ces vieux Romans et poëtes françois, où tu trouveras un ajourner pour faire jour, que les praticiens se sont fait propre : anuyter pour faire nuyt : assener pour frapper où on visoit, et proprement d'un coup de main : isnel pour leger et mille autres bons mots, que nous avons perdus, par nostre négligence. Ne doute point que le modéré usage de tels vocables ne donne grande majesté tant au vers comme à la prose : ainsi que font les reliques des saints aux croix, et autres sacrez joyaux dédiez au temple. » (pp. 34-35. Édition LÉON SÉCHÉ. Livre Ier, fin du chap. VI.)
Loin de moi la pensée de glorifier le patois aux dépens de notre belle langue française et de chercher à remplacer celle-ci par celui-là, comme on en accuse quelquefois, assez sottement, les zélateurs de ces études. Je me suis plu seulement à suivre un mouvement chaque jour plus nettement marqué. Depuis assez longtemps déjà, la question des patois a pris une grande importance ; de nombreuses publications ont paru, œuvres d'esprits distingués, qui n'ont point cru déchoir en publiant des Glossaires consciencieux et documentés, enrichis de toutes sortes de notes philologiques, morphologiques, grammaticales, etc.
Que dis-je ? Un nouvel alphabet a dû être inventé pour répondre aux innombrables inflexions des lettres ou en donner du moins un aperçu. Des appareils phonographiques ont été imaginés, et « depuis longtemps le laboratoire de M. l'abbé ROUSSELOT capte et fixe les ondes vocales... Il est possible, grâce à ces délicats appareils, de garder les inflexions chantantes du français qui se transforme et des patois qui vont disparaître.
Qu'est-ce donc que le patois ? « Je définis un patois, dit SAINTE-BEUVE, une ancienne langue qui a eu des malheurs, ou encore une langue toute jeune qui n'a pas encore fait fortune. » (A propos de JASMIN. CAUSERIES DU LUNDI, IV, 321.)
VICTOR HUGO disait plus magnifiquement, mais non sans justesse : « Les patois ébauchent la langue, comme aurore ébauche le jour. »
Et GEORGES SAND, à qui il s'adressait en ces termes poétiques, a fait, dans ses romans champêtres, le plus délicieux usage de ces vocables patois, inséparables du terroir qui les a créés.
Parlerai-je de l'exquis poète de la campagne, ANDRÉ THEURIET ? Je me contenterai de citer cette anecdote touchante qui suffirait, je pense, à gagner la cause du patois, même plaidée par son plus faible avocat.
« Sa petite patrie, à lui, c'était non pas celle de sa naissance — un hasard l'avait fait naître aux environs de Paris — mais celle de sa race, de sa jeunesse et de son cœur, cette patrie de la Lorraine, qui va de la Marne à la Meuse, c'est-à-dire le Barrois et l'Argonne... Il la chérissait tant que, lorsque fixé à Paris, il s'y maria, il voulut que ce fût avec une payse, avec La Payse ; et, dans un touchant poème, il nous a même conté comment sa tendresse, qui couvait depuis longtemps, éclata tout à coup, un jour que l'aimée laissa tomber de sa bouche, avec l'accent lorrain, un vieux mot du terroir natal. » (ANNALES POLITIQ. ET LITTÉR., 9 juin 1907.)
Un simple mot patois réunissant deux cœurs et liant pour la vie deux êtres, cela n'est pas banal, et, l'aveu nous venant d'ANDRÉ THEURIET « la caution n'est pas bourgeoise », comme on disait sous le Grand Roi.
Ce n'est donc pas sans attendrissement, je l'avouerai — au risque de faire sourire — que j'ai lu les lignes précédentes. C'est un autre genre d'émotion que celles qui suivent ont excité en moi.
« La Grande Armée est massée au bord du Niémen : au signal de l'Empereur deux cent mille hommes traversent le fleuve fatidique, par un orage épouvantable, sous les trombes d'une pluie diluvienne, à la lueur livide des éclairs. Chaque corps, en atteignant la terre ennemie, reçoit sa direction et se porte au point assigné et l'étape reprend, dit VANDAL : « forte, pénible, impérieusement réglée par une moite chaleur, qui faisait regretter à nos vétérans l'Espagne torride. Parfois, pour tromper la fatigue, les troupes se mettaient à chanter... Les vieux airs de nos provinces, les chansons bretonnes, provençales, picardes, normandes, mélancoliques ou gaies, enlevantes ou plaintives, apportaient à nos soldats exilés un écho de la patrie, un ressouvenir du foyer, arrivaient avec eux sur ces bords lointains, qui n'avaient jamais vu les hommes d'Occident... » (Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1910. ALBERT VANDAL, par M. DE SÉGUR.)
Un livre récent, consacré aux mœurs rurales, écrit dans une langue « presque toujours » vraiment paysanne, a, pour ces raisons mêmes, indépendamment des autres mérites de l'œuvre, obtenu un succès véritable et de bon aloi. Je veux parler de NONO, par GASTON ROUPNEL. Voici comment l'apprécie PIERRE MILLE :
« Les images abondent, claires, pressantes, caractéristiques, visibles et vraiment sorties de la terre d'où elles sont nées. Elles communiquent un plaisir sain, elles vous font respirer l'air de la Bourgogne, nourrissant, plantureux et vif, spirituel et tendre malgré la grossièreté de ceux qui parlent : l'écriture la plus directe et la plus française dont j'aie joui depuis bien longtemps... C'est ainsi que finit ce livre — et j'ai peur maintenant d'en avoir indignement parlé, — si abondant, si ému, si dru, avec ses gros mots de charretier, de vigneron et de rustre, mais qui ne font jamais scandale, parce qu'ils sont à leur place, parce qu'il faut qu'ils soient là : et tant de pitié qu'on le croirait venu des plaines russes ou des fiords de la Scandinavie, si cette pitié n'avait une sonorité toute autre, singulièrement païenne — et très de chez nous. » (LE TEMPS. En passant, n° du 15 décembre 1910.)
Je m'excuse de faire toutes ces citations ; mais, en vérité, je me récuse, en la question, pour cause de suspicion légitime, dirait-on au Palais. Je ne me sens pas assez impartial et préfère ici faire appel au jugement d'autrui.
Fort bien, me dira-t-on ; mais ces appréciations de poètes, de littérateurs, de romanciers sont elles-mêmes bien sujettes à caution. Le sentiment ne domine-t-il pas chez ces « intellectuels » et ne voient-ils pas sous un jour vraiment par trop favorable ces langues ou dialectes vraiment inférieurs ?
— Je vous entends « Quis custodiet custodes ? Quis spondebit pro sponsore ? »
Laissons alors parler un savant grammairien, M. FERDINAND BRUNOT (PRÉCIS DE GRAMMAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE.)
« La grammaire, telle que nous la comprenons, dégagée de tout lien traditionnel et indépendante comme une science, critique et juge par cela seul qu'elle explique. Indulgente aux prononciations populaires, favorable aux néologismes, c'est-à-dire aux barbarismes, quand ils sont bien faits, « protectrice des patois, frères méprisés du français, qu'elle réhabilite... (VI.)
« ... Les autres patois (que le provençal), peu connus et dédaignés, traités généralement comme des déformations du français, méritent aussi d'être considérés et étudiés, non point dans le but de les faire revivre, mais parce qu'ils fournissent pour l'étude du français même d'utiles comparaisons et des renseignements souvent précieux. Ils ont conservé des archaïsmes qui facilitent et contrôlent les recherches étymologiques, d'autre part ils nous présentent une image quelquefois frappante de ce qu'aurait donné le français livré à lui-même, se développant comme eux librement et en dehors de toute influence grammaticale et savante (p. 17).
« ... En outre on ira chercher (pour enrichir le vocabulaire français trop pauvre) dans les termes de métier, dans les dialectes, « provinciaux, gascons, poitevins, normands, lyonnois et d'autres pays, car toutes provinces, soient-elles maigres, servent aux plus fertiles de quelque chose, comme les plus faibles membres et les plus petits de l'homme servent aux plus nobles du corps... » (Id. Citation de RONSARD, p. 28.)
LITTRÉ et beaucoup d'autres philologues éminents, regrettent la disparition de nombreux mots populaires qui n'ont pas leur équivalent en français, où ils sont remplacés par des périphrases.
J'en lisais un dernièrement, dans un compte rendu des fêtes du millénaire de la Normandie. Le paysan normand hait les « horseins », ceux qui ne sont pas de chez lui. Trouvez dans notre dictionnaire un vocable aussi pittoresque et disant aussi fortement ce qu'il veut exprimer !
Et il est grand temps de les recueillir, tous ces vieux mots de patois, dont un grand nombre commencent à être désuets, connus seulement de très vieilles gens, et que rougissent d'employer nos jeunes ruraux — le peu qui en reste — tous tendant à devenir citadins !
Heureusement, par un retour dont il faut se féliciter, la ville, les citadins, reprennent pour leur compte ces vieilleries dont les ruraux ont hâte de se dépouiller.
« ... Il se produit même une étrange interversion qui est bien un des signes de l'anarchie qui sévit sur notre époque. Tandis que le village renie tout ce qui constituait sa vie propre, architecture, mobilier, costume, objets usuels, la ville s'en empare avec avidité. Pendant, notamment, que l'ambition suprême du villageois est de dépouiller l'habit si bien adapté à la race et au pays, pour revêtir quelque confection, ou de posséder un mobilier dont le modèle court tous les bazars de la ville, le citadin se livre à la chasse effrénée de tout ce qui porte le cachet spécial d'une région ou d'une époque. Bientôt, si ce n'est déjà fait, ce n'est que dans les villes que l'on pourra trouver des épaves de la vie rurale.
« Et le citadin, non plus que le villageois ne se rend compte qu'un meuble, un bibelot, même un ustensile familier, ne possèdent toute leur valeur que comme partie d'un ensemble.
« Cette interversion se manifeste aussi vivement dans le domaine moral. Tout ce qui était traditionnel, populaire, fait pour ou par la masse, destiné à des esprits simples, devient de plus en plus le fait d'un petit nombre et d'esprits raffinés. A mesure que la « plèbe » se détourne de ses usages ancestraux et abandonne ses goûts, ils deviennent l'apanage d'une aristocratie cérébrale. Les légendes, les croyances, les pratiques qui remontent à l'enfance des races, et qui jouèrent le rôle « d'articles de première nécessité » — moralement parlant — sont maintenant articles de luxe. » (ANSELME CHANGEUR. « LA PROTECTION DU VILLAGE. » Le Temps, 10 janvier 1911.)
Ce que font quelques-uns pour « l'architecture, le mobilier, la coutume, les objets usuels », nous avons essayé de le faire, nous, pour le vieux langage et les vieux usages de notre Anjou, dans les onze cent quinze pages de notre Glossaire. — A la bonne heure ; mais, m'objecteront des contradicteurs obstinés, et l'accent, cet horrible accent provincial, comment le défendrez-vous, l'illustrerez-vous ?
Déjà A. THEURIET a répondu, plus haut, à cet argument. Mais, ici encore, je laisserai la parole à l'un des plus spirituels défenseurs de « l'accent » que je connaisse :
- L'accent ?... Mais c'est un peu le pays qui vous suit !
- C'est un peu, cet accent, invisible bagage,
- Le parler de chez soi qu'on emporte en voyage !
- C'est, pour les malheureux, à l'exil obligés,
- Le patois qui déteint sur les mots étrangers !
(MIGUEL ZAMACOIS. LA FLEUR MERVEILLEUSE, acte II, sc. 5.)
Vous souriez, sans être désarmés. Voulez-vous l'opinion d'un diplomate, d'un homme plus sérieux — du moins par destination — qu'un joyeux poète comique ?
« On ferait un volume sur les travaux du port (Rosario de Santa Fé) exécutés par une Compagnie française sous la direction d'un de mes excellents compatriotes, M. PLANDROIS, originaire de mon village vendéen. Ces sortes de rencontres, à l'autre bout du monde, sont d'un charme particulier. On a navigué de longs jours et, l'imagination aidant, on se fait des prodiges de l'inconnu. Après des péripéties, la toile se lève, et le premier visage qui se présente, la première voix qui se fait entendre, évoque le pays natal. Des noms, des images, des souvenirs surgissent pour retentir au plus profond de l'âme en émotions inattendues. Fallait-il donc venir si loin pour se retrouver soudainement tout près de la terre dont aucun voyage ne peut détacher ? Jusque dans les montagnes du Brésil, n'ai-je pas rencontré une aimable Vendéenne avec ce bel « accent » de langue d'oil dont s'imprègne le verbe de notre RABELAIS ? (NOTES DE VOYAGE EN ARGENTINE ET AU BRÉSIL, par G. CLEMENCEAU. Illustration du 1er avril 1911, p. 249.)
Une dernière observation.
« Pourquoi donc notre pauvre langue vulgaire, qui avait donné de si belles promesses dans le ROMAN DE LA ROSE, au lieu de s'épanouir dans des œuvres maîtresses, comme l'italien, n'avait-elle produit depuis lors que des fleurs pâles, maladives, dégénérées ? Parce que nos savants la dédaignaient et continuaient de penser et d'écrire en latin, et que nos rimeurs, au lieu de prendre la jeune poésie par la main, et de la conduire sur les hauteurs où l'air et l'esprit sont plus purs, l'avaient promenée dans les bouges, comme maître François Villon, ou sur les coteaux de Meudon, comme maître Clément Marot et ceux de son école... (L. SÉCHÉ. NOTES ET COMMENTAIRE sur J. DU BELLAY, p. 72.)
Me voici arrivé au point où je dois appuyer de preuves toutes les affirmations que je viens d'avancer, et — ne voyez point là une vaine figure de rhétorique — je me sens pris d'une véritable inquiétude. Je me demande si l'on ne m'applique pas le vers de mon cher Horace :
Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu ?...
« Défendre et illustrer le patois angevin !... Assurément ce serait déjà « un honneur de l'avoir entrepris » ; j'espère mieux encore, gagner une cause si bien préparée par les excellents avocats dont j'ai invoqué l'autorité.
- ↑ (1) D'après le GLOSSAIRE ÉTYMOLOGIQUE ET HISTORIQUE DES PATOIS ET DES PARLERS DE L'ANJOU, comprenant le Glossaire proprement dit (18.293 mots), des Dialogues, Contes, Récits et Nouvelles en patois et le Folk-Lore de la province. Par A.-J. VERRIER, O. I., professeur honoraire, et R. ONILLON, instituteur au Longeron. Couronné par l'Académie française. (Prix Saintour, 1909.) 2 vol. in-8° de XXXII-528 et 587 pages, sur 2 colonnes. (Angers, GERMAIN et G. GRASSIN, éditeurs). Prix : 20 francs.
Défense et illustration du patois angevin d'Anatole-Joseph Verrier, G. Grassin imprimeur-éditeur (Angers), dans les Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences & arts d'Angers (ancienne Académie d'Angers fondée en 1685), cinquième série, tome XV, 1912 (notice Bnf) (livre).
Anatole-Joseph Verrier (Château-Gontier 1841 - Angers 1920), professeur et écrivain, auteurs de nombreuses œuvres littéraires et musicales, opéra comique, opérette-bouffe, chansons, dont Vive l'Anjou, ainsi que le Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou en collaboration avec René Onillon.
Autres documents :
Rapports avec la langue de Rabelais,
Sonnet en patois angevin,
Proverbes d'Anjou (Soland),
Traditions et superstitions,
Essai sur l'Angevin,
Glossaire de Ménière,
Langage à Lué,
Proverbes d'Anjou (V & O),
Discours du centenaire,
Chanson sur l'Anjou,
Glossaire de Verrier et Onillon,
Explication de mots,
Défense de l'angevin,
L'accent de chez nous,
Expressions angevines
et autres.
Littérature — Culture — Territoire — Patrimoine — Économie — Administrations — Documents