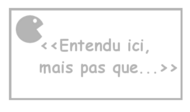« Fret' » : différence entre les versions
m (aussi) |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Adjectif et nom commun. | Adjectif et nom commun. | ||
En Anjou, ''fret''' pour froid. | En Anjou ([[Montjean-sur-Loire|Mj]], [[Briollay|By]], [[Saint-Aubin-de-Luigné|Sal]], [[La Ménitré|Mn]], [[Layon-Aubance|La]]), ''fret{{'}}'' (ou ''frét'', ''fré'') pour froid. | ||
Exemple : {{citation|On endure ben ein petit {{abréviation|ar|air}} de feu par eine fret’ pareille. }} (Verrier et Onillon, gloss.) | |||
{{Traduction|texte=froid}} | {{Traduction|texte=froid}} | ||
| Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
Et. — C'est le fr. Froid, avec la pronoc. du {{XVIe}} s. | Et. — C'est le fr. Froid, avec la pronoc. du {{XVIe}} s. | ||
et la finale forte. }} | et la finale forte. }} | ||
''[[Bouillard]] de fret{{'}}'', série de jours froids. | |||
On trouve aussi son utilisation en Charente, en Haute Bretagne, en Guadeloupe et au Québec : {{citation|Alerte générale! À soir, on fait peur au monde! Il va faire froid. ''Frette'', pardon! On va littéralement se les geler. L’heure est à la panique généralisée. }} (''Le Journal de Montréal'', 19 janv. 2019) | |||
=== Rimiau === | === Rimiau === | ||
| Ligne 30 : | Ligne 36 : | ||
{{-DicoNotes-}} | {{-DicoNotes-}} | ||
* Voir aussi [[ | * Voir aussi [[freud]], [[transon]], [[velin]], [[ferdir]]. | ||
Parler angevin | Parler angevin | ||
* [[Anatole-Joseph Verrier]] et [[René Onillon]], ''Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou'', Germain & Grassin (Angers), 1908, | * [[Anatole-Joseph Verrier]] et [[René Onillon]], ''Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou'', t. 1{{er}}, Germain & Grassin (Angers), 1908, p. 410 (et p. 340, 121) | ||
* [[Marc Leclerc]], ''Rimiaux d'Anjou - Sixième édition'', Au bibliophile angevin André Bruel (Angers), 1926, [[Rimiaux d'Anjou par M. Leclerc - Paisans|p. 8]] <small>([[ | * [[Marc Leclerc]], ''Rimiaux d'Anjou - Sixième édition'', Au bibliophile angevin André Bruel (Angers), 1926, [[Rimiaux d'Anjou par M. Leclerc - Paisans|p. 8]] <small>([[rimiau|def. rimiau]])</small> | ||
* Gérard Cherbonnier (dir.), ''Mots et expressions des patois angevins : petit dictionnaire'', Éd. du Petit Pavé (Brissac-Loire-Aubance), 2002 (4{{e}} édition, 1{{re}} en 1997), p. 43 | * Gérard Cherbonnier (dir.), ''Mots et expressions des patois angevins : petit dictionnaire'', Éd. du Petit Pavé (Brissac-Loire-Aubance), 2002 (4{{e}} édition, 1{{re}} en 1997), p. 43 | ||
* [[Dominique Fournier]], ''Mots d'galarne : dictionnaire pour bien bagouler notre patois aujourd'hui'', Cheminements (Le Coudray-Macouard), 1998, p. 122 | * [[Dominique Fournier]], ''Mots d'galarne : dictionnaire pour bien bagouler notre patois aujourd'hui'', coll. ''Les gens d'ici'', Cheminements (Le Coudray-Macouard), 1998, p. 122 | ||
* Jean-Paul Chauveau, ''Langue'', dans ''Anjou Maine-et-Loire'', coll. ''Encyclopédie Bonneton'', Christine Botton éditeur (Paris), 2010, p. 171 | * Jean-Paul Chauveau, ''Langue'', dans ''Anjou Maine-et-Loire'', coll. ''Encyclopédie Bonneton'', Christine Botton éditeur (Paris), 2010, p. 171 | ||
Autres régionalismes | Autres régionalismes | ||
* Charles Nisard, ''Étude sur le langage populaire ou patois de Paris et de sa banlieue'', Libr. A. Franck (Paris), 1872, p. 174 | |||
* Georges Dottin et J. Langouët, ''Les parlers de Haute Bretagne'', dans ''Glossaire du parler de Pléchâtel (canton de Bain, Ille-et-Vilaine)'', Plihon et Hommay (Rennes), 1901, p. LI | |||
* Georges Musset (avec Marcel Pellison et Charles Vigen), ''Dictionnaire des parlers de l'Aunis et de la Saintonge'', Tome II (D-M), Éditions des Régionalismes (Cressé), 2017 (1{{re}} édition 1931 Impr. de Masson fils), p. 132 | * Georges Musset (avec Marcel Pellison et Charles Vigen), ''Dictionnaire des parlers de l'Aunis et de la Saintonge'', Tome II (D-M), Éditions des Régionalismes (Cressé), 2017 (1{{re}} édition 1931 Impr. de Masson fils), p. 132 | ||
* Narcisse-Eutrope Dionne, ''Le Parler populaire des Canadiens français'', Laflamme & Proulx (Québec), 1909, p. 338 | |||
* Jean-Denis Gendron, ''D'où vient l'accent des Québécois ? Et celui des Parisiens ?'', Presses de l'Université Laval (Québec), 2007, p. 112 | * Jean-Denis Gendron, ''D'où vient l'accent des Québécois ? Et celui des Parisiens ?'', Presses de l'Université Laval (Québec), 2007, p. 112 | ||
* Simon-Pierre Savard-Tremblay, ''Froid extrême : à soir, on fait peur au monde!'', dans ''Le Journal de Montréal'', 19 janvier 2019 ([https://www.journaldemontreal.com/2019/01/19/froid-extreme--a-soir-on-fait-peur-au-monde lire]) | |||
* Henry Tourneux et Maurice Barbotin, ''Dictionnaire pratique du créole de Guadeloupe (Marie-Galante)'', Éditions Karthala (Paris), 2011, p. 143 | |||
| Ligne 47 : | Ligne 58 : | ||
[[Catégorie:Adjectif en angevin]] | [[Catégorie:Adjectif en angevin]] | ||
[[Catégorie:Nom commun en angevin]] | [[Catégorie:Nom commun en angevin]] | ||
[[Catégorie:Mot aussi au Canada]] | |||
Dernière version du 31 octobre 2025 à 18:09
En Anjou
- fret'
Mot
Adjectif et nom commun.
En Anjou (Mj, By, Sal, Mn, La), fret' (ou frét, fré) pour froid.
Exemple : « On endure ben ein petit ar de feu par eine fret’ pareille. » (Verrier et Onillon, gloss.)
Dans le glossaire de Verrier et Onillon : « Fret' (Mj., By., Sal.), adj. q. et s. m. et f. — Froid. Lorsqu'on l'emploie comme subst. on le fait indifféremment des deux genres. Ex. : Il fait eine fret à matin ! — Y fait frette à nuit ; le vent est haute galarne. — Queune fret qu'y fait ! — Syn. et d. de Freud. \\ Et. — C'est le fr. Froid, avec la pronoc. du XVIe s. et la finale forte. »
Bouillard de fret', série de jours froids.
On trouve aussi son utilisation en Charente, en Haute Bretagne, en Guadeloupe et au Québec : « Alerte générale! À soir, on fait peur au monde! Il va faire froid. Frette, pardon! On va littéralement se les geler. L’heure est à la panique généralisée. » (Le Journal de Montréal, 19 janv. 2019)
Rimiau
— M. Leclerc, Rimiaux d'Anjou
 Notes
Notes
Parler angevin
- Anatole-Joseph Verrier et René Onillon, Glossaire étymologique et historique des parlers et patois de l'Anjou, t. 1er, Germain & Grassin (Angers), 1908, p. 410 (et p. 340, 121)
- Marc Leclerc, Rimiaux d'Anjou - Sixième édition, Au bibliophile angevin André Bruel (Angers), 1926, p. 8 (def. rimiau)
- Gérard Cherbonnier (dir.), Mots et expressions des patois angevins : petit dictionnaire, Éd. du Petit Pavé (Brissac-Loire-Aubance), 2002 (4e édition, 1re en 1997), p. 43
- Dominique Fournier, Mots d'galarne : dictionnaire pour bien bagouler notre patois aujourd'hui, coll. Les gens d'ici, Cheminements (Le Coudray-Macouard), 1998, p. 122
- Jean-Paul Chauveau, Langue, dans Anjou Maine-et-Loire, coll. Encyclopédie Bonneton, Christine Botton éditeur (Paris), 2010, p. 171
Autres régionalismes
- Charles Nisard, Étude sur le langage populaire ou patois de Paris et de sa banlieue, Libr. A. Franck (Paris), 1872, p. 174
- Georges Dottin et J. Langouët, Les parlers de Haute Bretagne, dans Glossaire du parler de Pléchâtel (canton de Bain, Ille-et-Vilaine), Plihon et Hommay (Rennes), 1901, p. LI
- Georges Musset (avec Marcel Pellison et Charles Vigen), Dictionnaire des parlers de l'Aunis et de la Saintonge, Tome II (D-M), Éditions des Régionalismes (Cressé), 2017 (1re édition 1931 Impr. de Masson fils), p. 132
- Narcisse-Eutrope Dionne, Le Parler populaire des Canadiens français, Laflamme & Proulx (Québec), 1909, p. 338
- Jean-Denis Gendron, D'où vient l'accent des Québécois ? Et celui des Parisiens ?, Presses de l'Université Laval (Québec), 2007, p. 112
- Simon-Pierre Savard-Tremblay, Froid extrême : à soir, on fait peur au monde!, dans Le Journal de Montréal, 19 janvier 2019 (lire)
- Henry Tourneux et Maurice Barbotin, Dictionnaire pratique du créole de Guadeloupe (Marie-Galante), Éditions Karthala (Paris), 2011, p. 143