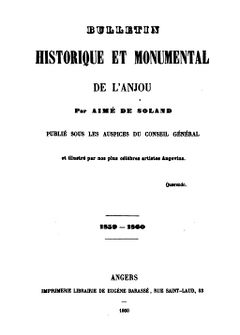Cris angevins au XIXe siècle
|
Tel est le cri par lequel les marchandes de sardines du
Port-Ligny annoncent leur présence dans nos rues. Le cri à
la vive au dard ne s'appliquait pas primitivement à la sardine
comme nous le verrons plus tard.
La sardine (clupea sprattus, L.), si abondante en Sardaigne, d'où elle tire son nom, ne fut commune sur les marchés de la province d'Anjou qu'au commencement du XVIe siècle. Avant cette époque, ce poisson était complétement inconnu à notre pays.
Il devint un objet important de commerce, grâce à une découverte faite par des pêcheurs bretons, et consistant dans une amorce formée d'œufs de morues. Cet appât jeté sur les côtes, attira et retint de nombreux bancs de sardines, et rendit la pèche des plus abondantes.
Dans un mémoire que l'intendant de Bretagne fournit en 1697 au duc de Bourgogne sur l'état de la généralité, on trouve que la seule ville de Port-Louis faisait annuellement quatre mille barriques de sardines, chaque barrique pesait neuf à dix milliers. Belle-Isle en faisait douze cents, et ainsi des autres ports de la province. On évalue à deux millions de bénéfice annuel, la pêche de la sardine sur les côtes de Bretagne. Il est arrivé de prendre d'un seul coup de filet de quoi remplir quarante tonneaux ; cette pêche est une des branches les plus considérables du commerce breton.
Quant au hareng (clupea harengus, L.), d'après des ordonnances de police, on voit que dès le douzième siècle il se vendait sur nos places publiques, et servait principalement de nourriture au peuple angevin pendant le carême et les jours d'abstinence.
Guillaume de Beaumont, évêque d'Angers, fit placer au XIIIe siècle, sur le chœur de la cathédrale Saint-Maurice un petit clocher où se trouvait une cloche d'argent prise, dit une légende, par saint Maurille, au cou d'un buffle sauvage, pendant le séjour du bienheureux évêque en Angleterre.
Tous les offices du carême étaient annoncés par le son de cette cloche ; le peuple l'appelait l'Harainier, cloche du hareng, en souvenir de la nourriture habituelle qu'il prenait dans les temps de mortification.
Le roi saint Louis rendit en 1254 une ordonnance pour la vente du hareng : dans cette ordonnance, ce poisson est désigné sous le nom de hearans.
La Hollande fut la première nation qui fit la pêche du hareng ; les bénéfices énormes qu'elle retira de ce commerce lui permit de soutenir de longues guerres contre la plupart des peuples de l'Europe, et de résister au monarque le plus puissant.
Au XVe siècle, le procédé pour saler le hareng fut trouvé par un pêcheur hollandais, nommé Guillaume Buckalz, mort à Biervliet, en 1447.
La Hollande lui a élevé un tombeau, sur lequel l'Empereur Charles-Quint voulut, lorsqu'il passa dans ce pays en 1556, avec la reine de Hongrie, sa sœur, manger un hareng pour honorer la mémoire de Buckalz.
Le procédé de Buckalz, suivi encore scrupuleusement de nos jours, donna une plus grande extension au commerce du hareng dans tout l'ouest de la France, et rendit ce poisson accessible aux plus petites bourses.
« Que la sévère postérité, dit M. de Lacépède, avant de prononcer son arrêt irrévocable sur ce Charles d'Autriche, dont le sceptre redouté faisait fléchir la moitié de l'Europe sous ses lois, rappelle que, plein de reconnaissance pour le simple pêcheur dont l'habileté dans l'art de pénétrer le hareng de sel marin avait ouvert une des sources les plus abondantes de la prospérité publique, il déposa l'orgueil du diadème, courba la tête victorieuse devant le tombeau de Guillaume Buckalz et rendit un hommage public à son importante découverte. »
L'alose (clupea alosa, L.) habite, comme on le sait,
l'Océan Atlantique septentrional, la mer Méditerranée et la
mer Caspienne ; au printemps, elles remontent en troupes
nombreuses nos grands fleuves et rivières, tels que la Seine,
la Loire, la Garonne, etc.
D'après M. Noël, de Rouen, il est pris dans cette ville treize à quatorze mille aloses chaque année. La Loire est le fleuve de France où se trouvent le plus d'aloses ; et d'après les statistiques, l'Anjou serait la contrée où la pêche de l'alose est la plus abondante.
Il nous est impossible de préciser l'époque où le commerce de l'alose se fît en Anjou. Le bon Bruneau de Tartifume, en signalant dans son ouvrage intitulé Philandinopolis, les antiques esbatz, plaisirs et délices du pays d'Anjou, s'écrie : « La Quarantaine venue, on va se promener, les uns pour voir la verdure des bleds nouveaux, des prez et des feuilles des arbres qui commencent à pousser, les aultres, pour voir pescher l'alloze, lancer un quarelet, un espervier, tirer un coup de ceinne ou voir faire quelqu'heureuse baillée. »
Au moyen-âge, les pêcheurs de Reculée avaient la réputation d'être les personnes, d'après un chroniqueur, qui savaient accomoder l'allose mieux que patissiers, cuisiniers, ni aultres gui soient en Anjou et en France.
Le poisson de mer qui figura le premier sur nos marchés d'Anjou fut la vive, ce fut elle, qui donna naissance à ce cri : Aux dards qui groulent, aux dards, à la vive aux dards ; à la vive.
La vive (trachinus draco, L.) et ses variétés, est un poisson de l'Océan, sa chair est blanche, ferme, feuilletée, sèche, d'une saveur excellente et très-bonne pour les convalescents qui la trouvent de facile digestion. Pline appelle ce poisson dragon de mer. Sa pêche n'a pas lieu sans danger. La vive avec les piquants de la première nageoire dorsale, fait des blessures très-dangereuses. Les piqûres occasionnées par ses aiguillons étaient tellement redoutées, qu'il existait à Angers un réglement de police, défendant aux poissonnières du Port-Ligny, de vendre de la vive avec les dards.
L'usage de manger de la vive a disparu peu à peu. La vive fut détrônée par la sardine, mais l'écaillère du port, fidèle aux traditions, répète ce qu'elle a entendu crier à sa mère, laquelle tenait le même cri de la bouche de sa grand'mère ; aussi d'ici longtemps, nos poissonnières crieront encore en parcourant nos rues avec leurs paniers de sardines, aux dards qui groulent, aux dards, à la vive aux dards, à la vive !
Il s'était formé, dans les provinces d'Anjou et de Bretagne,
une corporation dite la Corporation de la Guillotinée. C'était
une réunion de jeunes garçons allant, le 31 décembre, à la
porte des châteaux demander des étrennes ; ils recevaient un
certain nombre d'œufs, présent emblématique, dont l'origine
date de l'époque où l'année commençait à Pâques, voici la
chanson que chantaient, en Anjou, les Compagnons de la
Guillotinée.
- Arrivés, sont arrivés,
- Devant la porte d'un chevalier
- Ou d'un baron,
- Les Guillonnés, leur faut donner
- Aux Compagnons.
- Le bon Dieu vous baille tant de bœufs,
- Comme les poules auront d'œufs,
- Gentil seigneur,
- Ah ! donnez-leur la guillonnée
- Aux Compagnons.
- Le bon Dieu vous baille tant de poulets
- Que les moissons ont de bouquets.
- Gentil seigneur,
- Le bon Dieu vous baille tant de garçons,
- Qu'il est de plis aux cotillons.
Le 31 décembre n'était pas le seul jour de l'année où les Compagnons de la Guillonnée parcouraient les campagnes, en demandant des présents ; au premier mai, ils faisaient aussi une quête en chantant cette naïve chanson :
- En entrant dans cette cour
- Par amour,
- En entrant dans cette cour
- (1) Le mot Guillonnée vient du vieux cri gaulois : Au gui l'an neuf (l'an neuf). {Communication de M. Oger.)
- Nous saluons le seigneur
- Par honneur,
- Et la noble demoiselle,
- Et les petits enfants et tous
- Par amour.
- Les valets et chambrières,
- Madame de céans,
- Vous qui avez des filles,
- Faites-les se lever,
- Promptement qu'elles s'habillent.
- Nous leur passerons un anneau d'or au doigt,
- A l'arrivée du mois de mai ;
- Nous leur donnerons des bagues et des diamants,
- A l 'arrivée du doux printemps.
- Nous saluons le seigneur
- Entr' vous, braves gens
- Qu'avez des bœufs, des vaches,
- L'vez-vous d'bon matin
- A les mettre aux pâturages ;
- Ell' vous donn'ront du beurre aussi du lait,
- A l'arrivée du mois de mai.
- Entr'vous, jeunes filles,
- Qu'avez de la volaille,
- Mettez la main au nid
- N'apportez pas la paille ;
- Apportez-en dix-huit ou bien vingt,
- Et n'apportez pas les couvains.
- Si vous avez de nous donner,
- Ne nous faites pas attendre,
- J'ons du chemin à faire,
- Le point du jour avance ;
- Donnez-nous vat des œufs ou de l'argent
- Et renvoyez-nous promptement.
- Donnez-nous vat, du cidre ou bien du vin,
- Et renvoyez-nous au chemin.
- Si vous donnez des œufs,
- Nous prierons pour la poule ;
- Si vous donnez de l'argent,
- Nous prierons pour la bourse ;
- Nous prierons Dieu, l'bienheureux saint Nicolas
- Que la poule mange le renard,
- Nous prierons Dieu et l'bienheureux saint Vincent,
- Qu'la bourse se remplisse d'argent.
- En vous remerciant,
- Le présent est honnête ;
- Retournez vous coucher ;
- Barrez portes et fenêtres,
- Pour nous, j'allons toute la nuit chantant
- A l'arrivée du doux printemps.
Cris angevins. Bulletin historique et monumental de l'Anjou, par Aimé de Soland (1814-1910), Impr.-libr. Eugène Barassé (Angers), 1860 (notice BnF). Revue fondée par Aimé de Soland en 1852, rétrospective et contemporaine de l'histoire, de la littérature et des arts en Maine-et-Loire. Parution de 1852 à 1870, avec un dernier volume en 1881.
Aimé de Soland, publiciste, archéologue et naturaliste, né en 1814 à Angers et décédé dans cette même ville en 1910.
Du même auteur : Dictons relatifs aux mois, Dictons agricoles, Ruines de Rochefort.
Autres documents :
Dictons et croyances,
Croyances et superstitions,
Sorciers,
Coutumes,
Naissance,
Arbre de mai,
Mariage,
Dictons agricoles,
Cris angevins,
Moulin à venter,
Culture du chou,
Proverbes,
Chanson sur l'Anjou,
Sonnet en angevin.
Littérature — Culture — Territoire — Patrimoine — Économie — Administrations — Documents