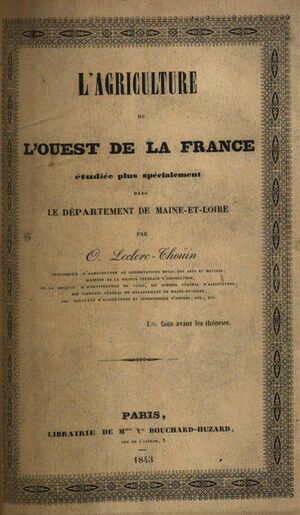Le Maine-et-Loire par O. Leclerc-Thoüin
|
Situation géographique, état ancien du pays, etc.
Le département de Maine-et-Loire est situé entre les 46° 59' et
les 47° de latitude septentrionale ; entre les 2° 6′ et les 3° 42′ de longitude
occidentale. Il a pour limites, au nord, le département de
la Mayenne ; au nord-ouest, celui d'Ille-et-Vilaine ; au nord-est,
celui de la Sarthe ; à l'est, il touche le département d'Indre-et-Loire ;
au sud-est, celui de la Vienne ; au sud, celui des Deux-Sèvres ;
au sud-ouest, celui de la Vendée, et à l'ouest le département
de la Loire-Inférieure. Il est donc de toutes parts compris
dans cette portion de la France si bien caractérisée, agricollement
parlant, sous le nom d'ouest.
Sa superficie est de 72 myriamètres carrés, et sa plus grande longueur de 11 myriamètres. Il représente à très-peu près la soixante-troisième partie du sol français. M. Adville a calculé qu'il dépasse de plus de 10 myriamètres carrés, l'étendue moyenne des quatre-vingt-six départements français.
Ce département renferme presque en totalité l'ancien gouvernement d'Anjou, une partie notable de celui de Saumur et une étroite lisière de celui du Poitou. Au nord et au nord-est, il a perdu Craon, Château-Gontier, la Flèche, le Lude ; à l'est, Château-la-Vallière, Savigné, Bourgueil ; au sud-est, il s'est enrichi de toute la portion du Saumurois comprise entre Fontevrault et le Thouet, en suivant une ligne irrégulière qui passe à une faible distance au delà d'Antoigné et en deçà de Saint-Cyr-les-Landes. Enfin au sud, à partir de Maulévrier, au lieu de se trouver limité comme l'était la province par le cours de la Moyne, il s'étend jusqu'à une faible distance de Mortagne, et, à l'est de cette ville, il longe la Sèvre nantaise jusqu'aux confins de la Loire-Inférieure.
L'Anjou, depuis le renversement du pouvoir romain, a changé plusieurs fois de circonscription et de gouvernement : sous les premiers rois francs, il fut partagé entre les Visigoths, qui possédèrent, pendant près d'un siècle, toute la partie située au delà de la Loire, les Bretons, qui s'étendirent jusqu'à la rivière de Maine, et les Francs, qui s'étaient emparés de la ville d'Angers et d'une portion des terres comprises entre la Sarthe et la Maine.
Clovis expulsa les Bretons et les Visigoths ; il laissa l'Anjou tout entier à ses successeurs. Louis le Débonnaire le réunit au Maine et à la Touraine, dont il ne forma qu'une seule province ; mais les guerres qui survinrent entre ce faible prince et ses fils ne laissèrent pas subsister longtemps un tel état de choses. Les Bretons recommencèrent leurs incursions, et les Normands s'emparèrent d'Angers, où ils se maintinrent jusqu'à ce que Charles le Chauve parvint à les en chasser, grâce à l'alliance qu'il contracta avec le chef breton. Il traita bientôt après avec ce dernier pour rentrer en possession du territoire envahi par les siens ; mais il semble qu'il lui en laissa le gouvernement, puisque, à cette époque, si l'on s'en rapporte aux données historiques les plus probables, l'Anjou se trouva de nouveau divisé entre quatre chefs principaux la portion située entre la Mayenne et la Sarthe, qui semble avoir réuni bientôt après, sous le nom de comté de Marche, tout l'Anjou breton, fut donnée à Robert le Fort, prince d'origine gauloise ; celle qui s'étend de Trèves à Saumur jusqu'en Touraine, entre la Loire et l'Authion, fut habitée par les Normands que Charles avait soumis en reprenant Angers ; il leur permit, de plus, de séjourner dans les îles appelées hautes et basses îles des Lombardières, à la condition qu'ils se feraient baptiser. Enfin Angers, toute la portion de la vallée comprise en deçà de Beaufort, entre la Loire et l'Authion, tout le pays qui s'étend de Beaufort au Loir, du Loir à la Sarthe, et, sur la rive gauche de la Loire, tout le reste de l'Anjou fut concédé aux comtes établis dans le chef-lieu de la province. Ceux-ci, qui, sous les rois de la première race, n'étaient, comme du temps des Romains, que des espèces de gouverneurs révocables chargés momentanément de l'administration de la justice et des armes, devinrent bientôt héréditaires.
Je ne serais pas entré dans les détails de ces divisions et subdivisions territoriales, s'il n'était permis de croire qu'elles ont eu et qu'elles exercent encore traditionnellement une certaine influence sur les systèmes agricoles adoptés dans le pays. Chose remarquable, ceux-ci sont presque rigoureusement en rapport avec les délimitations administratives, et celles-là rappellent les différents pouvoirs qui se sont partagé autrefois la contrée. L'arrondissement de Segré, voisin de la Bretagne, conserve beaucoup des usages bretons ; il possède, sur divers points, des animaux de race bretonne, des charrues de même origine ; il spécule sur l'élève des espèces chevaline et bovine. L'arrondissement de Baugé est entré dans une tout autre voie : il ne s'adonne à la culture des herbages qu'autant qu'il est rigoureusement nécessaire pour nourrir un très-petit nombre de bêtes de travail achetées dans les arrondissements voisins plutôt qu'élevées sur son territoire. Au lieu de bœufs de rente, il possède de nombreux cochons. L'arrondissement de Saumur, distrait de l'ancienne Touraine, spécule, avant tout, sur ses vins, et présente une population de vignerons. L'arrondissement de Beaupréau élève beaucoup moins que celui de Segré, il engraisse beaucoup plus. Celui d'Angers, par suite de sa position centrale, se rapproche un peu de tous les autres, mais, de même que le comté du même nom s'étendait plus vers l'ouest que vers l'est, de même aussi son agriculture actuelle a plus d'analogie avec celle de Beaupréau et de Segré qu'avec celle de Baugé et de Saumur.
Robert fut la souche des comtes héréditaires du Marche ; il eut plusieurs successeurs qui résidèrent principalement à Châteauneuf. Ingelger devint, de son côté, premier comte héréditaire d'Angers sous Louis le Bègue ; Foulque le Roux, son successeur, réunit en un seul gouvernement, par la volonté de Raoul, le comté du Marche et celui d'Angers.
Depuis lors, l'Anjou, soit qu'il conservât ou reprit son titre de comté, qu'il obéît directement à la couronne ou qu'il fût érigé plus tard en duché, ne forma plus qu'une seule province ou un seul gouvernement. Tous les historiens s'accordent à considérer les comtes d'Angers des deux premières races comme des hommes d'une haute distinction : l'un fut roi de Chypre, deux furent rois de Jérusalem, trois le devinrent d'Angleterre et léguèrent ce royaume à leur postérité. Charles, frère de saint Louis, commença la troisième race des comtes d'Anjou, qui devait devenir une véritable pépinière de souverains et d'hommes éminents. Pétrineau de Noulis disait, en parlant d'eux, à l'Académie des sciences et belles-lettres d'Angers, dans le programme d'une histoire inédite : « Des diverses races de ces comtes descendent deux maisons royales, celle de France et celle d'Angleterre ; on compte jusqu'à trente-cinq royaumes, neuf principautés, quatorze duchés et vingt comtés dont ils ont porté les titres. Ils donnèrent le mouvement à tout ce qui se passa de considérable dans l'Europe en ce temps-là, et leur vie fait une des plus belles pages de l'histoire de leur siècle.... »
Malheureusement, au milieu du récit de leur gloire personnelle, on parle à peine de ce qu'ils entreprirent pour le bien-être du peuple angevin. Ce n'est que vers la fin du XIe siècle qu'apparurent quelques traces écrites des lois et coutumes angevines. Vers 1270 fut fait un manuscrit ayant pour titre : Cy commencent les coutûmes glosées d'Anjou et du Maine. En 1360, on en écrivit un autre intitulé Ce sont les coutumes et usages du pays d'Anjou et du Maine en briève compilation mises, divisées en vingt parties principales par aucuns juges et conseillers desdits pays. En 1486, sous le règne de Charles VII, parut un premier travail imprimé sur la matière ; Louis XII le fit revoir et réformer en 1508, et, en 1509, il fut déposé au greffe de la cour.
De ces coutumes toutes féodales et cléricales, il reste désormais à peine quelques traces qui s'effacent de jour en jour ; aucune n'exerce une influence notable sur l'état présent de l'agriculture.
La propriété du sol présente une grande sécurité ; elle n'est grevée d'aucune charge passive en dehors du droit commun. Le parcours, à la vérité, subsiste encore sur plusieurs points, ainsi que je le dirai ultérieurement dans un des chapitres de ce travail, mais il ne s'exerce pas très en grand, et, malgré l'opposition des masses, toutes les fois, à ma connaissance, qu'un propriétaire a voulu s'y soustraire au moyen des clôtures, force est restée à la loi. Les droits d'usages qui existaient autrefois sur les propriétés seigneuriales ont été presque partout réglés par des triages, des cantonnements, et si, quelques contestations s'élèvent encore çà et là entre les usagers et les administrations locales, elles ne se rapportent qu'aux terrains communaux dont la contenance diminue désormais annuellement d'une manière remarquable.
Nulle part donc les traditions du passé n'ont peut-être légué moins d'entraves à l'avenir, et l'agriculture ne semble plus libre dans ses progrès.
Oscar Leclerc-Thoüin (1798 Paris-1845 Angers, agronome), L'agriculture de l'Ouest de la France étudiée plus spécialement dans le département de Maine-et-Loire, Vve Bouchard-Huzard (Paris), 1843, p. 1-4 (notice BnF).
Autres documents : Livre des tournois de René d'Anjou, Famille Du Bellay par J.-F. Bodin, Peste en Anjou de 1348 à 1362, Peste à Angers de 1582 à 1584, Le docteur Farge (1895), Dictionnaire Célestin Port, Notes historiques sur Montrevault.